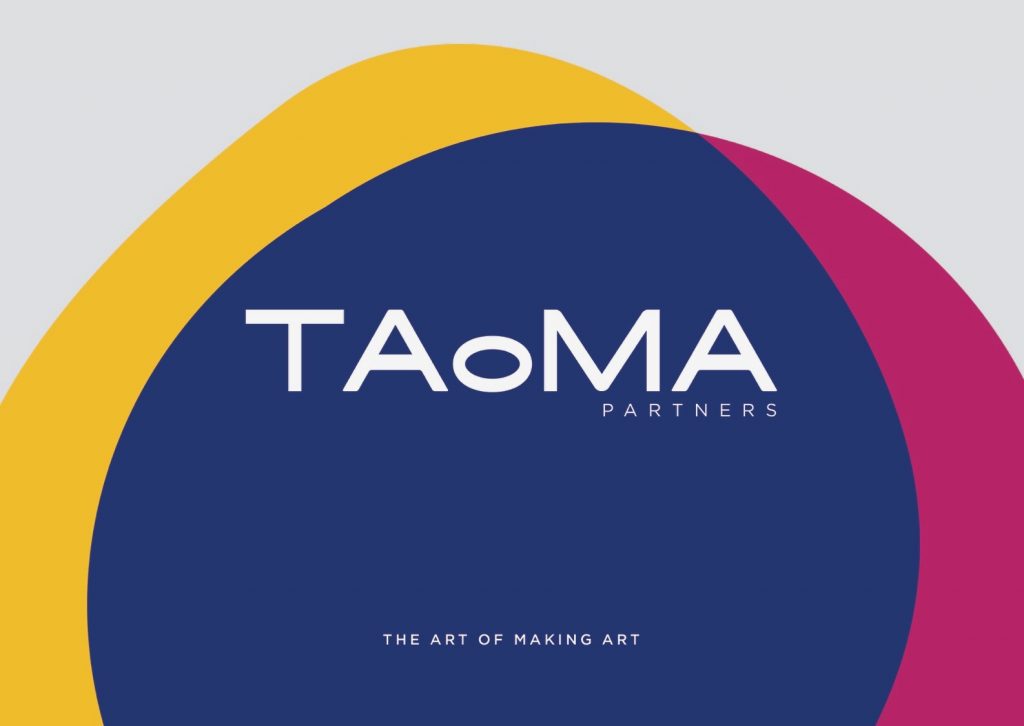26
septembre
2023
Andy Warhol, contrefacteur ? Débat sur la notion américaine de fair use et la transformation artistique
Author:
teamtaomanews
Dans une décision du 18 mai 2023[1], la Cour suprême des États-Unis a dû s’interroger sur l’appréciation du fair use, à propos d’une œuvre d’Andy Warhol réalisée à partir d’un portrait photographique de Prince et utilisée pour illustrer un article de presse.
Le conflit juridique autour des portraits de Prince
L’affaire trouve son origine en 1984, lorsque le magazine Vanity Fair sollicite Lynn Goldsmith, photographe de renom, pour que soient utilisée l’une de ses photographies du chanteur Prince et la confier à Andy Warhol, en vue de réaliser l’une de ses fameuses sérigraphies, en guise d’illustration d’un article consacré au chanteur.
Ce sont finalement pas moins de 13 déclinaisons coloriées de la photographie, qui ont été réalisées par le roi du pop art, sans l’accord de la photographe.
Peu après le décès de Prince en 2016, Vanity Fair a versé 10.000 dollars à la Fondation Warhol pour re-publier au sein de son magazine un nouvel article sur Prince, illustré d’une déclinaison orangée de la série de portraits de Prince réalisée par Andy Warhol. En revanche, Vanity Fair n’a pas contacté Lynn Goldsmith à cette occasion.
La photographe, a vainement tenté d’obtenir une indemnisation au titre de l’utilisation de sa photographie, auprès de la Fondation Warhol. Cette dernière a préféré porter l’affaire devant les tribunaux.
Violation du copyright ou exception de fair use ?
Si le copyright permet à un auteur de protéger son œuvre contre toute exploitation non-autorisée, le concept américain de fair use permet au juge d’apprécier en cas de litige, si l’utilisation d’une œuvre par un tiers est loyale ou non, ce qui lui permet d’échapper à toute condamnation en matière de contrefaçon.
Dans le cas d’espèce, c’est précisément ce que soutenait la Fondation Warhol pour considérer que l’utilisation de la photographie de Lynn Goldmsith ne constituait pas une violation du copyright.
La Cour d’appel a refusé de faire application de cette notion pour exonérer la Fondation Warhol, laquelle a formé un recours devant la Cour suprême. Elle repose et analyse les différents critères d’appréciation du fair use.
La Cour Suprême rejette l’application du fair use en raison d’une transformation de l’œuvre originale insuffisante
En l’espèce, même si la Cour Suprême revient en partie sur le raisonnement juridique de la Cour d’appel, elle refuse de considérer que la sérigraphie réalisée par Andy Warhol pouvait bénéficier de l’exception de faire use.
En l’espèce, la Cour Suprême se concentre sur le premier critère du fair use, à savoir le but et le caractère de cet usage : pour que ce critère soit rempli, elle rappelle que l’usage de l’œuvre originale par l’œuvre seconde doit être transformatif, c’est-à-dire que l’œuvre première doit être transformée par la création d’une nouvelle information.
Et la Cour Suprême estime que la série de portraits de Warhol ne constituait pas une transformation suffisante pour justifier le fair use.
Bien que les portraits soient immédiatement identifiables comme étant du style distinctif de Warhol, cela restait néanmoins objectivement un portrait de Prince ayant juste un style différent. La Cour ajoute que l’usage que pouvait faire Lynn Goldsmith de sa photographie, était le même que celui que la Fondation Andy Warhol pouvait faire des sérigraphies.
La Cour en conclut que les critères requis pour bénéficier de l’exception du fair use n’étaient pas remplis.
Autant dire que la technique bien connue d’Andy Warhol consistant à recoloriser des clichés existants n’est pas regardée comme un apport créatif significatif…
Juliette DANJEAN
Stagiaire pôle avocat
Alain HAZAN
Avocat associé
[1] Andy Warhol for the visual art, inc. v. Goldsmith Et Al.
09
février
2023
Pour la deuxième année consécutive, TAoMA Partners est présent dans le classement 2023 WTR 1000, édité par World Trademark Review !
Le cabinet est, cette année, classé dans la catégorie Silver et considéré comme « l’un des meilleurs cabinets de France » avec des collaborateurs qui « possèdent d’excellentes connaissances et expériences, représentent une gamme de clients de premier plan et fournissent des conseils clairs et perspicaces. »
Comme l’année dernière, 3 de nos associés, Anne Messas, Gaëlle Loinger- Benamran et Malaurie Pantalacci sont distingués à titre individuel. Notre nouvel associé Jean-Charles Nicollet, a également rejoint le classement.
Anne Messas : « [Anne] Messas est un opérateur stratégique qui possède une expérience à la fois contentieuse et non contentieuse. »
Gaëlle Loinger-Benamran : « Basée à Strasbourg, [Gaëlle] Loinger-Benamran est experte dans le traitement des dossiers de marques, de noms de domaine et de droits d’auteur. »
Malaurie Pantalacci : « Malaurie adopte une approche pragmatique, directe et sans détours. Elle est très efficace, digne de confiance et une excellente communicante. »
Jean-Charles Nicollet : « Le nouvel associé [Jean-Charles] Nicollet offre des conseils axés sur les affaires à ses clients des secteurs des médias, de la mode et de la technologie. »
Merci à nos clients et partenaires pour leur confiance et leur fidélité.
Félicitations à notre équipe de choc, sans laquelle rien ne serait possible !
20
janvier
2023
Replay de l’évènement « Marketing d’influence, métaverse, NFT : nouveaux vecteurs de la contrefaçon ? »
Pour celles et ceux qui n’ont pas pu être là, un replay est à retrouver ci-dessous et sur la chaîne YouTube TAoMA Event ✨ 👇
L’occasion de remercier à nouveau nos brillantes intervenantes :
🎤 Delphine Sarfati – Directrice Générale de l’UNIFAB – Union des Fabricants
🎤 Constance Laennec-Cuny – Responsable Propriété Intellectuelle
🎤 Anne Messas – Avocate et Médiatrice, Associée et co-fondatrice de TAoMA Partners
🎤 Anne LAPORTE – Avocate chez TAoMA Partners et membre de TAoMA Influence , une offre de services spécifique créée et proposée par TAoMA Partners
Le prochain évènement TAoMA aura lieu en mars, on vous en dévoile plus bientôt ! Stay tuned ! 🤓
10
août
2022
Minecraft refuse les NFT au nom de l’inclusion
Pendant que les juristes et acteurs économiques s’agitent pour s’adapter au marché des NFT et du metaverse, les plus jeunes se réjouissent car un éditeur de jeu et non des moindres a dit non.
Dans son communiqué du 20 juillet 2022, l’éditeur de Minecraft, le jeu vidéo le plus téléchargé au monde, prend position contre la logique de spéculation, de rareté et d’exclusion, qui, selon lui, est véhiculée par l’usage actuel des NFT.
L’éditeur Mojang Studios détenu depuis 2014 par Microsoft, s’inscrit fermement contre l’intégration des NFT au jeu Minecraft, au nom des valeurs d’égalité d’accès aux contenus du jeu et d’inclusion créative.
« NFTs are not inclusive of all our community and create a scenario of the haves and the have-nots. The speculative pricing and investment mentality around NFTs takes the focus away from playing the game and encourages profiteering, which we think is inconsistent with the long-term joy and success of our players. » (« Les NFTs ne sont pas inclusifs pour l’ensemble de notre communauté et créent un scénario entre ceux qui ont et ceux qui n’ont pas. La mentalité de prix spéculatif et d’investissement qui entoure les NFTs détourne l’attention du jeu et encourage le profit, ce qui, selon nous, est incompatible avec la joie et le succès à long terme de nos joueurs. »)
Cette décision est conforme à l’état d’esprit de nombreux gamers qui rejettent les NFT en les associant à un univers de spéculation mais aussi à cause des conséquences graves et non maîtrisées pour l’instant de la blockchain sur l’environnement.
L’univers du web 3.0 n’en finit pas de susciter débat.
TAoMA suit cela de très près.
Stay tuned
Anne Messas
Avocat à la cour
08
mars
2022
TAoMA Partners fait son entrée dans le classement international WTR 1000 !
Toute l’équipe de TAoMA Partners est très fière de faire son entrée dans le classement 2022 WTR 1000, édité par World Trademark Review !
« TAoMA Partners fait sa première apparition dans le WTR 1000 pour 2022 grâce aux éloges enthousiastes de ses clients – à la fois pour le cabinet dans son ensemble et pour ses praticiens vedettes. «
En effet, si le cabinet est classé parmi les meilleurs français, 3 de nos associés sont également distinguées à titre individuel :
Gaëlle Loinger-Benamran: « Gaëlle not only is perfectly aware of the law and its development, but knows how to adapt to any type of client, assessing the right level of risk they are willing to take. She has a problem-solving mindset and approach, is articulate, and takes the time to make sure everything is crystal clear for everyone. »
Anne Messas : « Anne provides sound legal advice and gets great results for her clients. »
Malaurie Pantalacci : « Malaurie is recommended for her professionalism, her ability to understand our issues and find solutions, and the clarity of her explanations and recommendations. She listens to our problems and works to understand our company. »
Nous tenons à remercier nos clients et partenaires pour leur confiance !
10
février
2022
Biens, services et contenus numériques : satisfaits ou remboursés ?
Author:
teamtaomanews
Bonne nouvelle pour les geeks ! L’Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, étend le domaine de la garantie légale de conformité aux biens contenant des éléments numériques ainsi qu’aux services et contenus numériques.
En parallèle, le vendeur professionnel serre les dents : cette extension s’accompagne d’un renforcement de ses obligations à l’égard du consommateur, notamment son obligation précontractuelle d’information.
À quoi s’applique cette garantie ?
Jusqu’alors, seuls les biens physiques et les contrats de vente bénéficiaient de la garantie légale de conformité. Désormais, sont susceptibles d’en bénéficier les contrats conclus entre un vendeur professionnel et un consommateur ayant pour objet la fourniture :
d’un bien comportant des éléments numériques comme un objet connecté telle qu’une montre intelligente.
d’un service numérique comme une application de réseau social ou une plateforme VOD.
d’un contenu numérique comme le téléchargement d’un fichier vidéo, d’un enregistrement audio ou un jeu numérique.
Comment appliquer la notion de conformité au e-commerce B2C ?
La garantie légale de conformité permet de s’assurer que le vendeur professionnel délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’à l’usage qui en est attendu par le consommateur.
Le Code de la consommation liste les principaux critères de la conformité au contrat en matière de biens, services et contenus numériques[1] lesquels doivent notamment :
correspondre avec la description, au type, à la quantité et à la qualité notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité ou toute autre caractéristique prévue au contrat.
être propres à tout usage spécial recherché par le consommateur.
être délivrés avec tous les accessoires et les instructions d’installation.
être mis à jour conformément au contrat.
Attention aux données personnelles ! Professionnels responsables de traitement, soyez vigilants. Tout manquement dans le traitement des données personnelles peut être considéré comme un défaut de conformité du bien, du contenu ou du service fourni s’il entraîne le non-respect d’un ou de plusieurs critères de conformité[2].
Quelles sont les conséquences du défaut de conformité ?
En cas de non-conformité, le consommateur a le choix de la sentence à l’égard du professionnel :
Il peut faire procéder à une exécution forcée en nature et a le droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
ou se prévaloir d’une exception d’inexécution c’est-à-dire qu’il a le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombe.
Quelle est la durée de la garantie légale de conformité ?
Les délais de la garantie légale de conformité étendue sont différents selon que le défaut de conformité affecte :
un bien comportant des éléments numériques pour lequel le délai de garantie est de 2 ans suivant l’achat, la réparation ou le remplacement du produit.
un contenu ou un service numérique pour lequel la durée de la garantie est de 2 ans pour une fourniture unique de contenus numériques, de la durée de l’abonnement pour les services continus.
Attention à la preuve ! Il existe un régime de présomption de défaut de conformité au bénéfice du consommateur. Pour l’objet connecté, les défauts de conformité qui apparaissent dans le délai de 2 ans sont présumés exister au moment de la délivrance du bien sauf incompatibilité avec la nature du bien. Pour les contenus ou services numériques cette présomption est fixée à 1 an.
Un renforcement des obligations du vendeur professionnel
Une obligation de motiver le refus
Le professionnel n’est pas dans l’obligation de se plier à la volonté du consommateur insatisfait, si la modalité choisie par ce dernier est impossible à réaliser ou qu’elle entraîne des coûts disproportionnés[3].
Mais alors le vendeur professionnel devra être en mesure de justifier les raisons de son refus par écrit, sur un support durable adressé au consommateur.
Une obligation précontractuelle d’information renforcée
Outre cette obligation de motivation, l’extension du régime de conformité légale renforce l’obligation précontractuelle d’information qui pèse sur tout professionnel.
Ainsi, lorsque le bien comporte un contenu ou un service numérique, le vendeur est tenu d’informer le consommateur de la disponibilité des mises à jour de sécurité nécessaires au maintien de la conformité du bien, du service ou contenu numérique et des conséquences liées à la non-installation.
Décharge de responsabilité en cas de défaut d’installation des mises à jour
En revanche, le professionnel ne sera pas responsable des défauts résultant de l’absence d’installation de mises à jour par le consommateur, à condition toutefois que ce dernier ait été dûment informé de leur disponibilité et des conséquences liées à la non-installation.
Le vendeur professionnel de biens, contenus ou services numériques doit donc rédiger ses Conditions Générales de Vente (CGV) avec précision et penser à y inclure une information sur la garantie légale de conformité, sa mise en œuvre et son contenu.
TAoMA Partners demeure à votre disposition pour vous accompagner dans la conformité de vos sites e-commerce et dans la rédaction et l’actualisation de vos Conditions Générales de Vente.
Ludovic de Carné
Avocat à la Cour
Delphine Monfront
Élève-Avocate
Abonnez-vous à la newsletter de TAoMA !
Cet article ne remplace pas une consultation auprès d’un CPI ou d’un avocat, indispensable à la bonne évaluation de vos besoins.
[1] Article L. 217-4 du Code de la consommation Ces critères de conformité au contrat sont complétés par une série de critères énumérés à l’article L. 217-5 du Code de la consommation : il est (i) propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, (ii) possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillons ou de modèles, (iii) les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente au moment de la conclusion du contrat, (iv) délivré avec tous les accessoires, (vi) fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, (vii) correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques que le consommateur peut légitimement attendre le pour des biens de même type.
[2] Article L. 217-6 du Code de la consommation.
[3] Article L. 217-12 du Code de la consommation.
01
février
2022
La preuve par constat d’achat, oui ! Mais qui peut procéder à l’achat?
Author:
teamtaomanews
Dans notre newsletter du 12 janvier 2021, nous avions rappelé l’importance de la date choisie pour établir les constats d’huissier, lesquels permettent avant tout procès de démontrer la commercialisation d’un produit contrefaisant dans une boutique ou sur un site en ligne.
S’il est fréquent qu’un constat d’huissier soit fourni aux débats, il convient toutefois de s’interroger sur les liens éventuels de dépendance entre la personne qui assiste l’huissier de justice et le requérant.
En effet, dans un arrêt du 16 décembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour d’appel de Douai a rappelé les exigences d’indépendance entre le requérant et le tiers acheteur qui assiste l’huissier instrumentaire.
A l’origine de ce litige, une demande reconventionnelle en concurrence déloyale initiée par la société Vaillant contre la société Cartospé pour des actes de concurrence déloyale commis à son encontre et consistant à ne pas avoir respecté les normes relatives aux emballages.
Au soutien de sa demande, la société Vaillant a fourni un constat d’achat de deux lots de 10 emballages de la société Cartospé, effectué sur le site Internet de cette dernière et établi par huissier de justice à Paris en 2014.
Or, comme l’a relevé la Cour d’appel de Douai, il résulte du procès-verbal de l’huissier instrumentaire que la personne qui a procédé à l’achat de cartons est Mme X., alors élève-avocat du cabinet Linklaters lui-même avocat de la société Vaillant, requérante, laquelle n’a pas fait pas état de cette qualité lors de l’achat mais a au contraire, fait état de l’adresse d’une société de gestion immobilière située 32 rue de Malte à Paris 70011 ainsi que d’une adresse Gmail personnelle et non pas des coordonnées du cabinet Linklaters étant ajouté que l’huissier constatant ne mentionne pas plus la qualité de Mme X. Il en résulte que le constat d’achat du 26 mai 2014 n’a pas été réalisé par une personne indépendante de la partie requérante et doit être annulé de même que les actes subséquents des 13 et 26 juin 2014[1].
Rappelons que si l’huissier de justice se borne le plus souvent à constater l’achat de l’article litigieux par un tiers acheteur, ce dernier doit toutefois être indépendant de la partie requérante.
Cette condition d’indépendance a notamment été rappelée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 25 janvier 2017[2].
A la lumière de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile, la Cour a rappelé que le droit à un procès équitable (…) commande que la personne qui assiste l’huissier instrumentaire lors de l’établissement d’un procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante.
Ce nouvel arrêt vient renforcer les exigences d’indépendance entre le tiers acheteur et le requérant, démontrant de nouveau la grande sévérité des juges en matière de constats d’huissier.
Ainsi, si l’utilité des constats d’huissier n’est plus à démontrer en raison de leur force probante reconnue par les tribunaux, il convient toutefois d’être particulièrement vigilant sur le choix du tiers acheteur, sous peine de rejet de ce mode de preuve par les juridictions.
Gaëlle Bermejo
Juriste
[1] Cour d’appel de Douai, ch. 2 – sec. 1, arrêt du 16 décembre 2021 – Cartospé-Packaging / Cartonnage Vaillant & Astra Inks (arrêt)
[2] Cour de cassation, arrêt du 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.210
21
janvier
2022
L’AC Milan perd son match (et sa marque) devant le TUE
Author:
teamtaomanews
Les Allemands ont remporté un match judiciaire en droit des marques contre les Italiens (3-0) dans une affaire opposant l’Associazione Calcio Milan SpA (AC Milan), célèbre club de football, à la société de droit allemand InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG.
La première mi-temps a débuté le 6 avril 2017 avec une opposition formée devant l’Office européen des marques (EUIPO) par cette société allemande, sur la base de sa marque verbale allemande MILAN, enregistrée notamment en classe 16, à l’encontre d’une demande de marque du club de football Italien.
Ce dernier, par une demande de marque internationale désignant l’Union européenne n°1329545, souhaitait protéger sa marque semi-figurative (ACM 1899 AC MILAN) dans les vingt-sept États de l’Union pour des produits en classe 16 de la Classification de Nice, à savoir : « Papier ; carton ; couvertures de livres ; colle pour la papeterie ou le ménage ; articles de papeterie ; papier à copier [articles de papeterie] ; papier à lettres ; [articles de papeterie] ; marqueurs ; agrafes de bureau ; fournitures pour le dessin ; fournitures pour l’écriture ; fournitures scolaires ; gommes à effacer ; encres ; correcteurs liquides ; gabarits [articles de papeterie] ; crayons ; crayons fusains ; crayons d’ardoise ; mines de crayon ; stylos [articles de bureau] ; plumes d’acier ; porte-crayons ; porte-mines ; porte-plume ; billes pour stylos à bille ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; carnets ; tampons encreurs ; taille-crayons ; tire-lignes ».
La société allemande obtient une première fois gain de cause par une décision rendue le 30 novembre 2018, dans laquelle l’EUIPO a reconnu l’opposition justifiée dans son intégralité.
Mécontent de cette décision, le club de football italien, dans le cadre d’une seconde mi-temps, a formé un recours. Mais la deuxième chambre de recours de l’EUIPO le rejette et confirme la décision de la division d’opposition dans son intégralité.
Le Milan AC tente alors une dernière attaque devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE) en contestant l’appréciation des preuves d’usage de la marque antérieure réalisée par la chambre de recours, y compris celle de l’altération du caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’enregistrée.
Il ajoute que la chambre de recours n’a pas pris en compte la renommée de la demande de marque contestée aux fins de l’appréciation du risque de confusion, notamment en ce qui concerne les similitudes conceptuelles entre les signes.
Le TUE, par une décision en date du 10 novembre 2021, marque un coup d’arrêt au match et confirme la victoire de la société allemande. En effet, il juge que l’usage sérieux de la marque antérieure, ainsi que le risque de confusion entre les marques en cause, a été dûment démontré et justifié.
Sur l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée
D’une part, le TUE confirme que les preuves d’usage produites par la société allemande sont suffisantes pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure en Allemagne.
Les pièces fournies par la société allemande (factures, catalogues…), prises dans leur ensemble, permettent de démontrer qu’elle s’est efforcée de maintenir ou acquérir une position commerciale sur le marché en cause, étant précisé, par ailleurs, que le TUE confirme la jurisprudence constante selon laquelle des pièces datées en dehors de la période pertinente peuvent être prises en compte pour apporter la preuve d’une exploitation commerciale réelle et sérieuse de la marque.
D’autre part, le TUE suit le raisonnement de la chambre de recours de l’EUIPO selon lequel l’usage qui est fait de la marque antérieure sur le marché n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée, à savoir sous une forme verbale.
En effet, l’ajout d’un élément figuratif représentant la tête d’un oiseau, bien que non négligeable, demeure secondaire dans l’impression d’ensemble dès lors que, pour une partie du public pertinent, il vient renforcer la signification du mot « MILAN » et, en tout état de cause, il est constant que les éléments figuratifs ont une importance moindre du point de vue du consommateur.
Sur l’appréciation du risque de confusion
Tout en contestant les ressemblances visuelles et phonétiques entre les marques, l’AC Milan a tenté une attaque assez intéressante sur le terrain de l’appréciation conceptuelle.
En effet, l’AC Milan faisait notamment valoir que le public pertinent associera la marque demandée au célèbre club de football italien, entraînant ainsi des différences conceptuelles entre les signes susceptibles de neutraliser les ressemblances visuelles et phonétiques.
Une telle approche n’est pas nouvelle dans le domaine footballistique puisque, dans le cadre de l’Affaire MESSI, opposant les marques MESSI et MASSI, l’argument avait été retenu par le TUE, dans une décision confirmée par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) [1].
Néanmoins, dans le cas présent, le TUE semble poser une limite à cette jurisprudence, confirmée par la suite dans le cadre d’une affaire impliquant la marque patronymique de la célèbre chanteuse MILEY CYRUS [2]. Le TUE répond que « seule la renommée de la marque antérieure, et non celle de la marque demandée, doit être prise en compte pour apprécier si la similitude des produits désignés par deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion ».
Si l’argument semble favorable aux noms patronymiques célèbres, tel ne semble donc pas le cas pour certains organismes, comme ce célèbre club de football.
Le match juridique Italie-Allemagne finit ainsi par trois buts au bénéfice des Allemands et la demande de marque semi-figurative ACM 1899 AC MILAN n° 1329545 est donc rejetée à l’enregistrement pour les produits qu’elle désigne en classe 16.
Leila Zorkot
Stagiaire juriste
Baptiste Kuentzmann
Juriste
[1] CJUE, 17 septembre 2020, Affaires jointes C-449/18 P et C-474/18 P
[2] TUE, 16 juin 2021, Affaire T-368/20
Lire la décision sur le site Curia
21
janvier
2022
Parasitisme: Konbini « furious » de la reprise de son format « Fast & Curious »
Difficile de passer à côté des populaires interviews « Fast & Curious » du média Konbini lorsque l’on est présent sur les réseaux sociaux.
Ces vidéos de 2 minutes et 30 secondes présentent une personnalité qui répond, sur un rythme soutenu, à une série de questions sous la forme d’un choix entre deux propositions courtes. La popularité de ce format court et décalé n’a cessé d’augmenter depuis sa création en 2015.
Néanmoins, il n’est pas loisible aux tiers d’en reprendre les caractéristiques. C’est en tout cas ce qu’a décidé le tribunal judiciaire de Paris dans une décision du 1er juillet 2021.
Dans cette affaire, un candidat à une élection municipale, en campagne électorale, avait diffusé sur sa page Facebook une vidéo intitulée « Fast & Cabourg » dans laquelle il se prêtait au jeu de l’interview sous un format identique à celui imaginé par Konbini. Au regard de cette appropriation, la réaction de la société ne s’est pas fait attendre : elle a assigné le candidat sur le fondement du parasitisme afin d’obtenir des dommages et intérêts.
L’action de Konbini contre le candidat est recevable
Afin de se défendre, le candidat attaqué a d’abord tenté de soulever l’irrecevabilité de l’action de la demanderesse, aux motifs qu’il ne serait ni l’auteur, ni le producteur de la vidéo litigieuse, ni même l’administrateur de la page Facebook sur laquelle la vidéo a été postée. Selon lui, aucune action ne pouvait donc être dirigée à son encontre.
Le Tribunal considère que le candidat s’abstenant de désigner l’administrateur de la page Facebook ou l’auteur de la vidéo litigieuse ne démontrait pas que celle-ci aurait été produite par un tiers. Il en déduit ainsi que le candidat doit être regardé comme le producteur de la vidéo, et que l’action de Konbini est alors recevable.
Le format « Fast & Curious » n’est pas protégeable sur le fondement du droit d’auteur
Dans le cadre de son analyse au fond, le tribunal commence par s’interroger sur la protection du format « Fast & Curious » fondée sur le droit d’auteur, alors même que la société KONBINI ne formulait aucune demande sur le fondement de la contrefaçon dans le cadre de son action judiciaire. En effet, si la société KONBINI a pu revendiquer des droits d’auteur sur ce format dans son courrier de mise en demeure à l’attention du candidat interviewé, il a finalement abandonné cette revendication dans le cadre de son action judiciaire.
Dans sa décision, le tribunal commence par préciser la notion de « format » en décrivant ce support comme « le document qui définit précisément et de façon complète, en principe sous une forme écrite, le contenu d’un programme audiovisuel. Il a vocation à être décliné pour la réalisation des émissions ».
Ensuite, et bien que les formats audiovisuels ne soient pas listés explicitement par l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle répertoriant les œuvres susceptibles de protection par le droit d’auteur, le tribunal vient rappeler, sans surprise, que ces types de créations sont susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur dès lors qu’elles sont originales et portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
Pour autant, dans le cas présent, le tribunal écarte la qualité d’œuvre au format « Fast & Curious », jugeant que la société KONBINI s’abstient de caractériser l’originalité du format en cause.
Cette décision ne dénie donc pas toute originalité au format « Fast & Curious » mais se contente d’écarter la protection par le droit d’auteur faute pour la société KONBINI de l’avoir revendiquée.
La protection du format sur le fondement du parasitisme
La notion de parasitisme, construite par la jurisprudence sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, prend le relais. Une aubaine pour la demanderesse qui appuie sa demande de dommages et intérêts sur ce seul fondement.
Le tribunal constate ainsi que la vidéo litigieuse « reproduit à l’identique l’ensemble des caractéristiques du format, y compris ses aspects sonores et ses détails visuels ».
Il en conclut que le parasitisme est caractérisé, « au regard de l’absence de coût financier et d’effort de création personnelle du candidat, aux fins de promotion de sa candidature aux élections municipales ».
Il est intéressant de noter que les juges du fond refusent d’appliquer les deux exceptions soulevées par le candidat à l’élection municipale pour tenter d’échapper à sa responsabilité :
L’exception de parodie d’abord : le tribunal relève que cette exception est inapplicable en l’espèce, l’action n’étant pas fondée sur le droit d’auteur, et considère en tout état de cause que la vidéo litigeuse ne présente aucune différence perceptible avec l’œuvre d’origine et ne constitue donc pas une manifestation d’humour ou une raillerie ;
La liberté d’expression : le tribunal considère que la vidéo mettant en scène l’interview du candidat ne participe nullement à un débat d’intérêt général, les questions posées se bornant à interroger le candidat sur des expériences personnelles sans lien avec la politique et écarte ainsi l’exception de liberté d’expression. En tout état de cause, l’application d’une telle exception paraissait hasardeuse dans la mesure où la liberté d’expression touche plus au discours tenu qu’au format choisi pour le délivrer. Or, en l’occurrence, c’est bien le choix du format qui était reproché par la société KONBINI.
Pour toutes ces raisons, le tribunal conclut à la responsabilité du candidat et le condamne à des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par la société KONBINI. On notera tout de même que cette décision refuse de prononcer une condamnation au titre du préjudice financier et d’image invoqué par la société KONBINI, considérant qu’aucun élément ne venait attester du dommage allégué.
Delphine MONFRONT
Élève-avocate
Anne LAPORTE
Avocate
Lire la décision sur Légifrance
Load more
Loading...