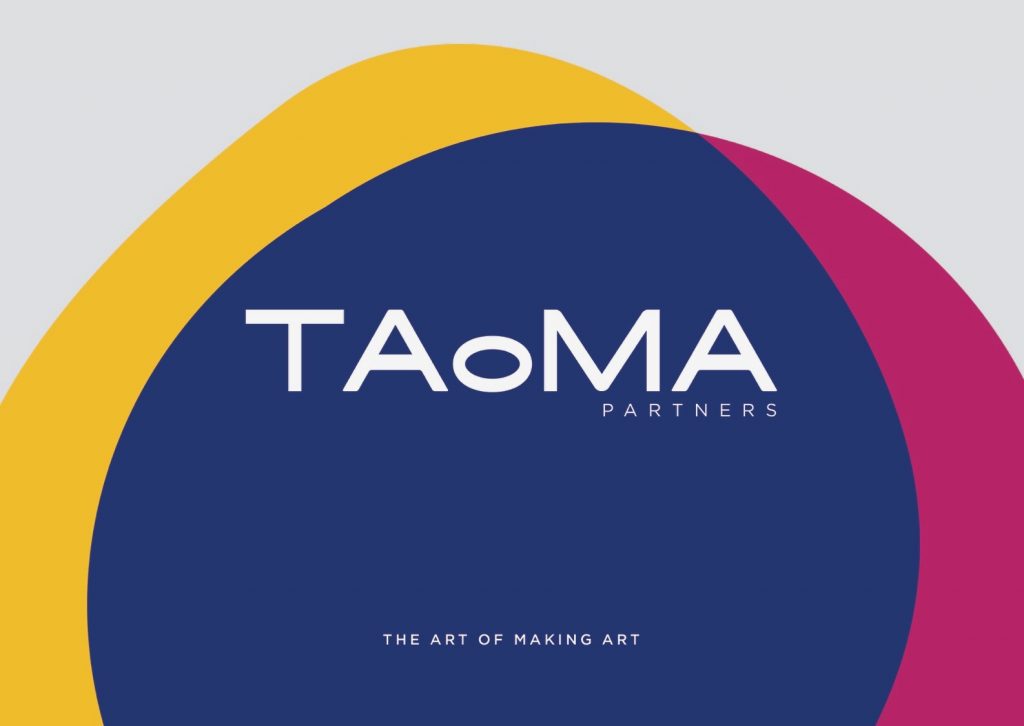18
juillet
2023
Nestlé & AMPC : 0% de contrefaçon mais 100% de cacao !
La société AMCP commercialise le chocolat qu’elle fabrique sous forme de tablettes de dégustation sous la marque « Encuentro », l’emballage de ces produits s’appelle « Encuentro 70% Haïti », représentant une cabosse de couleur orange à reflets jaune apposée sur un fond uni couvrant la quasi-totalité de l’emballage.
Elle reproche à la société Nestlé la contrefaçon de droit d’auteur sur ses emballages et la concurrence déloyale, pour avoir reproduit les caractéristiques essentielles de son packaging dans sa tablette de chocolat « Incoa ».
Tout en retenant l’originalité du packaging, le Tribunal judiciaire de Paris rejette pourtant ses demandes le 13 avril 2023[1]
Le tribunal retient l’originalité du packaging « Encuentro 70% Haïti »
Même si certains éléments sont dictés par la fonction technique de l’emballage, et d’autres banals, ces éléments, pris dans leur ensemble, attestent d’une opposition entre une étiquette à la typographie d’imprimerie traditionnelle et une représentation stylisée, sous forme d’aquarelle, d’une cabosse de cacao accentuant ses couleurs naturelles orangée ou violette.
Les emballages sont présentés de façon lisse, avec des couleurs vives et des effets de dégradés et de reflets.
Le tribunal retient que cette présentation véhicule une atmosphère artisanale et sobre d’authenticité et de qualité, combinée de façon originale, avec une représentation graphique colorée pouvant évoquer un élément passionnel et la gourmandise associée au produit.
Le tribunal rejette le fondement de la contrefaçon
Le tribunal est ferme et indique que les éléments l’ayant mené à reconnaître l’originalité du packaging du demandeur n’existent pas pour la tablette Incoa de la société Nestlé, dont la version de la cabosse de cacao est épurée, simple, droite et sans reflets.
Par ailleurs, le tribunal rejette le fondement de la concurrence déloyale car le consommateur du chocolat Encuentro d’attention élevée ne pourra pas confondre des produits qui se distinguent par leurs marques, leurs prix et leurs qualités, la faute n’est donc pas démontrée.
En effet, le public pertinent, au cas d’espèce acheteur du chocolat Encuentro, est considéré comme recherchant un produit de qualité gustative et par sa composition, il dépensera donc un prix élevé pour acheter du chocolat, la tablette Encuentro étant vendue au prix de 7 à 8 euros. Le chocolat Encuentro est un chocolat haut de gamme, ciblant un public d’amateurs ou de connaisseurs et distribué dans un réseau de commerce au détail et spécialisé.
Le consommateur est donc considéré comme disposant d’un niveau d’attention élevée.
Au contraire, la tablette Incoa est un chocolat industriel ciblant un large public et commercialisée dans un réseau étendu de magasins de grande surface.
Il est donc peu probable que le public pertinent soit en situation de confondre les deux produits.
Cette position est assez surprenante dans la mesure où les tablettes de chocolat sont un produit ordinaire dans la consommation quotidienne et à destination du grand public, le degré d’attention du consommateur devrait être qualifié de moyen, comme cela a été jugé à propos de boissons rafraichissantes[2] par exemple.
L’attention plus élevée du consommateur est généralement retenue lorsque les produits sont spécifiques et onéreux comme les vins de Champagne[3].
Ici, c’est sans doute la qualité certaine du chocolat qui en fait un produit cher conduisant donc à considérer le consommateur qui va l’acheter comme ayant un niveau d’attention élevée.
Enfin, les fondements de parasitisme et pratiques commerciales trompeuses sont également écartés.
Nestlé et son chocolat ont encore de beaux jours devant eux…
Des questions sur vos droits d’auteur et leur protection ? Les équipes de TAoMA sont à votre disposition pour en discuter !
Emeline JET
Elève-avocate
Jean-Charles Nicollet
Associé – Conseil en Propriété Industrielle
[1] TJ Paris, du 13 avril 2023 n°21/09930
[2] TUE, 23 février 2022 Ancor Group GmbH c/ EUIPO
[3] Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre, 1e section, 29 juillet 2021, RG n° 19/13569
11
juillet
2022
Quand la comédie familiale tourne au drame pour les coauteurs d’une pièce de théâtre objet de multiples versions
Author:
TAoMA
La transformation des œuvres de l’esprit est source d’un contentieux judiciaire inépuisable. La Cour d’appel de Paris a récemment rappelé que les coauteurs d’une pièce de théâtre adaptée d’une œuvre composite, issue d’une œuvre préexistante, sont tenus de recueillir l’autorisation préalable de son auteur, peu importe que l’auteur de l’œuvre préexistante ait contribué à la création de la dernière version.
Un imbroglio juridique démêlé à la faveur de l’auteur de l’œuvre composite « Ma Belle-Mère, Mon Ex et Moi » !
– ACTE I –
La pièce « Ma Belle-Mère, Mon Ex et Moi » (V1) écrite en 2011 a fait l’objet en 2014 d’une seconde version, portant le même titre (V2). L’auteur de l’œuvre préexistante n’a pas participé à l’écriture de cette version mais indique « avoir consenti, une fois mis devant le fait accompli, au dépôt de celle-ci à la SACD (…) et à son exploitation ». En 2016, une troisième version voit le jour, intitulée « Ma Belle-Mère et Moi, 9 mois après » (V3), créée par trois coauteurs, dont l’auteur de l’œuvre initiale.
– ACTE II –
S’estimant lésé, l’auteur de la V2 qui n’a pas donné son autorisation préalable pour la création de la V3 a introduit une action en contrefaçon à l’encontre des coauteurs de cette dernière version. Les juges du fond ayant, en partie, accueilli cette demande (TGI de Paris, 11 octobre 2019, n°17/09967), la société de production et deux des trois coauteurs de la V3 ont interjeté appel de la décision.
– ACTE III –
Bien que la situation ne manque pas d’ironie, l’auteur de l’œuvre initiale ayant participé à la création de l’œuvre dans sa dernière version, la Cour d’appel de Paris est purement et simplement venue appliquer les principes du Code de la propriété intellectuelle protégeant les œuvres transformatrices et rappeler que le créateur d’une œuvre de l’esprit, fut-elle composite, jouit pleinement de ses droits d’auteur, comme tout auteur.
• Scène 1 : la V2 est une œuvre composite, dérivée de la V1
En application de l’article L. 113-2 du CPI aux termes duquel « est dite composite l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière » :
La Cour considère que l’auteur de la V2 démontre être à l’origine de choix arbitraires et d’apports originaux (portant sur 66% du texte global de la V1) révélant l’empreinte de sa personnalité notamment concernant : la trame de l’histoire relative à la grossesse des deux actrices, l’héritage conditionné à la naissance d’un enfant et plus généralement le caractère des personnages.
La Cour estime que la V2 « Ma Belle-Mère, Mon Ex et Moi » est donc une œuvre composite créée sans contribution de la part de l’auteur de l’œuvre préexistante, mais avec son autorisation, bénéficiant ainsi d’une protection au titre du droit d’auteur.
• Scène 2 : la V3 est une œuvre dérivée de la V2 et non de la V1
En application de l’article L. 113-4 du CPI aux termes duquel « l’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante » :
La Cour estime, à l’issue d’une analyse in concreto de la situation et d’un travail de comparaison, que la V3 se présente comme la suite logique et chronologique de la V2 et que les coauteurs de la V3 se sont manifestement inspirés des éléments clés de l’intrigue de la V2 et non de la version 1.
La Cour confirme que les coauteurs de la V3 auraient donc dû solliciter l’accord préalable de l’auteur de la V2 (ce qu’ils ont au demeurant tenté de faire, sans succès…).
– ACTE IV –
Les deux coauteurs de la V3 et la société de production, ont donc été condamné pour contrefaçon de droits d’auteur au paiement de la somme de 5.000 euros pour atteinte au droit moral de l’auteur de la V2 et de 20.000 euros en réparation de son préjudice matériel.
On notera que l’auteur de l’œuvre préexistante, mis devant le fait accompli pour autoriser l’œuvre dans sa version intermédiaire, n’est pas condamné pour son rôle mineur dans la création de la V3 : maigre consolation qui vient rappeler la force de la protection accordée par le droit d’auteur aux œuvres transformatrices.
– ACTE V –
Une affaire atypique en raison de la participation de l’auteur de l’œuvre préexistante à l’œuvre qualifiée de contrefaisante. Les droits de l’œuvre initiale ne l’emportent pas sur ceux de l’œuvre composite. La prudence est donc toujours de mise pour les créateurs qui entendent s’inspirer d’œuvres préexistantes.
Une affaire d’ex et de belles-mères qui n’a pas fini de faire parler…
Ludovic de Carne
Avocat à la Cour
11
juillet
2022
Pas de fausse note pour Ed Sheeran innocenté de plagiat devant la haute cour de justice britannique
Author:
TAoMA
« Shape of You », le hit d’Ed Sheeran à plus de 3 milliards de Stream sur Spotify, près de 6 milliards de vues sur YouTube depuis sa sortie en janvier 2017, est-il un plagiat de « Oh Why » ? C’est la question à laquelle a répondu la Haute Cour de Justice britannique dans un arrêt attendu du 6 avril 2022.
Samy Chokri et Ross O’Donoghue sont les auteurs d’une chanson intitulée « Oh Why » sortie en juin 2015. Estimant qu’une partie du refrain de « Shape of You », d’Ed Sheeran était un plagiat de leurs chansons, Samy Chokri et Ross O’Donoghue ont demandé à être crédités comme auteurs. En réponse, Ed Sheeran intente une action à leur encontre afin d’obtenir une déclaration de non-contrefaçon. Pour se défendre, Samy Chokri et Ross O’Donoghue forment une demande reconventionnelle en plagiat.
Aux termes d’une analyse argumentée, la Haute Cour de Justice conclut que la star britannique n’a pas copié la chanson « Oh Why ».
En effet, elle considère qu’il existe de très nombreuses différences entre les œuvres en cause, et qu’il n’est pas prouvé qu’Ed Sheeran ait eu accès à l’œuvre prétendument plagiée compte tenu de son « succès limité ». Dans ces conditions, elle en déduit que le chanteur pop n’a pas copié « délibérément » ni « inconsciemment » la chanson « Oh Why » et condamne les auteurs-compositeurs qui l’accusaient de plagiat à verser à Ed Sheeran plus d’un million d’euros d’indemnisation.
En souhaitant que le chanteur britannique connaisse la même issue dans la procédure en cours Outre-Atlantique aux termes de laquelle sa ballade « Thinking out Loud » est accusée de beaucoup trop s’inspirer de la chanson « Let’s Get it On » de Marvin Gaye.
Nathan Audinet
Stagiaire – Pôle avocats
Anne Laporte
Avocate à la cour
11
juillet
2022
Un blouson noir dans la tourmente : un designer attaque lego devant le tribunal de district du connecticut après la reproduction d’un blouson en cuir noir conçu par ses soins
Author:
TAoMA
Dans le cadre d’une collaboration, Netflix a récemment octroyé une licence au groupe Lego pour la création d’un set inspiré de la série de téléréalité Queer Eye, diffusée sur la plateforme de streaming.
Lego s’est toutefois vu attaquer en contrefaçon de droit d’auteur par le designer James Concannon en décembre dernier après la reproduction d’une de ses vestes sur l’une des figurines de ce set. La veste en question avait été offerte par le designer à Antoni Porowski, membre du casting de Queer Eye, et avait été portée par ce dernier lors du tournage de la série.
Revendication d’une violation du droit d’auteur portant sur le blouson
Selon le designer, aucune licence n’a été concédée à Netflix pour l’utilisation de sa veste dans son émission. Effet boule de neige, aucune autorisation n’a dès lors pu être donnée à Lego de reproduire son œuvre au sein du set en question et ainsi l’exploiter commercialement, qui plus est à titre gratuit. Concannon entend ainsi obtenir réparation pour la violation de son droit d’auteur.
Contrefaçon or not contrefaçon ? Concannon pourrait toutefois se prendre une veste, ses chances de succès étant plus qu’incertaines. En effet, quand bien même l’originalité de la veste serait démontrée, il appartiendra ensuite au designer de prouver que la version Lego de son œuvre est suffisamment similaire à la veste originale.
Existence d’une licence implicite ?
Par ailleurs, Lego affirme qu’en offrant la veste à Porowski, en sachant pertinemment qu’il la porterait sur le tournage, le designer aurait concédé une licence implicite à Netflix d’utiliser son œuvre dans son émission.
Qui de la brique ou du blouson aura le dernier mot, affaire à suivre…
Juliette Parisot
Stagiaire – Pôle CPI
Blandine Lemoine
Conseil en Propriété Industrielle
14
avril
2022
Tendances de mode et constance jurisprudentielle
La cour d’appel de Paris vient de donner une nouvelle illustration de l’appréciation délicate de la contrefaçon en matière de créations dans le domaine de la mode, où la reconnaissance de l’originalité des œuvres se heurte au recours au « fonds commun » de la mode et à l’inscription dans des tendances saisonnières.
L’arrêt du 15 février 2022
L’affaire est classique : deux créatrices de bijoux se disputent un marché pour leurs créations. La première considère que la seconde a imité ses créations et l’assigne devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale. Le tribunal rejette les demandes et la cour d’appel confirme le jugement.
Sans rentrer dans les détails de l’espèce, impliquant également deux autres parties, on retiendra que la cour a considéré que les bijoux créés par la demanderesse, ne se différenciant des traditionnels bracelets brésiliens portés par « les hippies et les surfeurs » (mais aussi par certains avocats, comme la cour semble l’ignorer) que par l’utilisation de couleurs et de matières plus nobles et féminines, ne font que « revisiter » un genre et ne peuvent donc pas bénéficier de la protection du droit d’auteur.
La cour ajoute que d’autres créateurs participent à la « même tendance ‘bohème chic’ » puisant « à un fonds commun de l’accessoire de mode », ce qui caractérise une démarche relevant d’une « inspiration mutuelle entre créateurs ».
Par conséquent, s’il existe des ressemblances flagrantes entre les bijoux, le fait qu’ils s’inscrivent dans un même fonds commun exclut leur caractère original. La même raison justifie également, aux yeux de la cour, le rejet des demandes en concurrence déloyale puisque l’inscription dans un fonds commun exclut que les ressemblances soient liées à une volonté fautive de créer un risque de confusion – a fortiori en l’absence de notoriété des bijoux de la demanderesse.
Une « tendance » jurisprudentielle confirmée
Les créations appartenant au domaine de la mode ont un statut à part en droit d’auteur. Leurs créateurs doivent donc résoudre la quadrature du cercle en se distinguant (par l’empreinte de leur personnalité) tout en participant à un courant saisonnier destiné à engendrer ou participer à un succès commercial.
Si l’appréciation du caractère protégeable des œuvres peut être différente dans chaque espèce, la solution rappelée dans cet arrêt n’est pas nouvelle.
Ainsi, le simple fait de s’inscrire dans une tendance de mode n’empêche pas nécessairement de voir reconnue l’originalité des bijoux, vêtements ou accessoires, comme l’a retenu un arrêt de cassation déjà ancien : « s’il est exact que la contrefaçon de modèles d’industries saisonnières de l’habillement et de la parure ne saurait résulter de la seule ressemblance, dans leur ligne générale, entre le modèle prétendument contrefait et celui argué de contrefaçon, lorsque l’un et l’autre se situent dans une même tendance de la mode, il en est autrement lorsque l’article contrefait comporte des éléments spécifiques de nouveauté et d’originalité reproduits par le modèle contrefaisant » (Cass. crim., 29 janvier 1991, n° 90-81903).
Mais inversement, l’absence d’élément spécifique d’originalité indépendant de la reprise d’éléments provenant d’un fonds commun de la mode peut priver l’œuvre de protection. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation en 2014, jugeant que la cour d’appel avait « souverainement estimé que l’ajout de semelles à picots qui s’inscrivait dans une tendance de la mode était insuffisant pour témoigner de l’empreinte de la personnalité de son auteur et que le modèle revendiqué n’était dès lors pas éligible à la protection conférée par le droit d’auteur » (Cass. civ. 1e, 20 mars 2014, n° 12-18518).
De récentes décisions de cours d’appel adoptent la même grille d’analyse et prennent en compte les éléments tendanciels de ce secteur commercial, souvent pour rejeter la protection par le droit d’auteur.
Par exemple, en matière de contrefaçon de droits d’auteur, une décision du 22 octobre 2019 (CA Paris, RG n° 17/20261) pour des blouson « bombers » et une décision du 16 novembre 2021 (CA Paris, RG n° 18/20990) pour des sacs à main. Et en matière de concurrence déloyale, une décision du 26 mars 2021 (CA Paris, RG n° 19/19593) pour des chaussures et une décision du 19 novembre 2020 (CA Versailles, RG n° 19/03448) pour des sacs à dos et cartables.
Les créateurs doivent donc être alertés sur la fragilité de leurs droits et sur la nécessité, pour les consolider, de se détacher autant que possible du « fonds commun », dès le processus de création : l’octroi de la protection par le droit d’auteur viendra alors récompenser la prise de risque économique qu’il y a à se démarquer d’une tendance saisonnière.
Décision commentée : Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 1, 15 février 2022, RG n° 19-12641 (communiquée sur demande à contact-avocat@taoma-partners.fr)
Jérémie Leroy-Ringuet
Avocat à la cour
21
janvier
2022
Parasitisme: Konbini « furious » de la reprise de son format « Fast & Curious »
Difficile de passer à côté des populaires interviews « Fast & Curious » du média Konbini lorsque l’on est présent sur les réseaux sociaux.
Ces vidéos de 2 minutes et 30 secondes présentent une personnalité qui répond, sur un rythme soutenu, à une série de questions sous la forme d’un choix entre deux propositions courtes. La popularité de ce format court et décalé n’a cessé d’augmenter depuis sa création en 2015.
Néanmoins, il n’est pas loisible aux tiers d’en reprendre les caractéristiques. C’est en tout cas ce qu’a décidé le tribunal judiciaire de Paris dans une décision du 1er juillet 2021.
Dans cette affaire, un candidat à une élection municipale, en campagne électorale, avait diffusé sur sa page Facebook une vidéo intitulée « Fast & Cabourg » dans laquelle il se prêtait au jeu de l’interview sous un format identique à celui imaginé par Konbini. Au regard de cette appropriation, la réaction de la société ne s’est pas fait attendre : elle a assigné le candidat sur le fondement du parasitisme afin d’obtenir des dommages et intérêts.
L’action de Konbini contre le candidat est recevable
Afin de se défendre, le candidat attaqué a d’abord tenté de soulever l’irrecevabilité de l’action de la demanderesse, aux motifs qu’il ne serait ni l’auteur, ni le producteur de la vidéo litigieuse, ni même l’administrateur de la page Facebook sur laquelle la vidéo a été postée. Selon lui, aucune action ne pouvait donc être dirigée à son encontre.
Le Tribunal considère que le candidat s’abstenant de désigner l’administrateur de la page Facebook ou l’auteur de la vidéo litigieuse ne démontrait pas que celle-ci aurait été produite par un tiers. Il en déduit ainsi que le candidat doit être regardé comme le producteur de la vidéo, et que l’action de Konbini est alors recevable.
Le format « Fast & Curious » n’est pas protégeable sur le fondement du droit d’auteur
Dans le cadre de son analyse au fond, le tribunal commence par s’interroger sur la protection du format « Fast & Curious » fondée sur le droit d’auteur, alors même que la société KONBINI ne formulait aucune demande sur le fondement de la contrefaçon dans le cadre de son action judiciaire. En effet, si la société KONBINI a pu revendiquer des droits d’auteur sur ce format dans son courrier de mise en demeure à l’attention du candidat interviewé, il a finalement abandonné cette revendication dans le cadre de son action judiciaire.
Dans sa décision, le tribunal commence par préciser la notion de « format » en décrivant ce support comme « le document qui définit précisément et de façon complète, en principe sous une forme écrite, le contenu d’un programme audiovisuel. Il a vocation à être décliné pour la réalisation des émissions ».
Ensuite, et bien que les formats audiovisuels ne soient pas listés explicitement par l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle répertoriant les œuvres susceptibles de protection par le droit d’auteur, le tribunal vient rappeler, sans surprise, que ces types de créations sont susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur dès lors qu’elles sont originales et portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
Pour autant, dans le cas présent, le tribunal écarte la qualité d’œuvre au format « Fast & Curious », jugeant que la société KONBINI s’abstient de caractériser l’originalité du format en cause.
Cette décision ne dénie donc pas toute originalité au format « Fast & Curious » mais se contente d’écarter la protection par le droit d’auteur faute pour la société KONBINI de l’avoir revendiquée.
La protection du format sur le fondement du parasitisme
La notion de parasitisme, construite par la jurisprudence sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, prend le relais. Une aubaine pour la demanderesse qui appuie sa demande de dommages et intérêts sur ce seul fondement.
Le tribunal constate ainsi que la vidéo litigieuse « reproduit à l’identique l’ensemble des caractéristiques du format, y compris ses aspects sonores et ses détails visuels ».
Il en conclut que le parasitisme est caractérisé, « au regard de l’absence de coût financier et d’effort de création personnelle du candidat, aux fins de promotion de sa candidature aux élections municipales ».
Il est intéressant de noter que les juges du fond refusent d’appliquer les deux exceptions soulevées par le candidat à l’élection municipale pour tenter d’échapper à sa responsabilité :
L’exception de parodie d’abord : le tribunal relève que cette exception est inapplicable en l’espèce, l’action n’étant pas fondée sur le droit d’auteur, et considère en tout état de cause que la vidéo litigeuse ne présente aucune différence perceptible avec l’œuvre d’origine et ne constitue donc pas une manifestation d’humour ou une raillerie ;
La liberté d’expression : le tribunal considère que la vidéo mettant en scène l’interview du candidat ne participe nullement à un débat d’intérêt général, les questions posées se bornant à interroger le candidat sur des expériences personnelles sans lien avec la politique et écarte ainsi l’exception de liberté d’expression. En tout état de cause, l’application d’une telle exception paraissait hasardeuse dans la mesure où la liberté d’expression touche plus au discours tenu qu’au format choisi pour le délivrer. Or, en l’occurrence, c’est bien le choix du format qui était reproché par la société KONBINI.
Pour toutes ces raisons, le tribunal conclut à la responsabilité du candidat et le condamne à des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par la société KONBINI. On notera tout de même que cette décision refuse de prononcer une condamnation au titre du préjudice financier et d’image invoqué par la société KONBINI, considérant qu’aucun élément ne venait attester du dommage allégué.
Delphine MONFRONT
Élève-avocate
Anne LAPORTE
Avocate
Lire la décision sur Légifrance
05
juillet
2021
Tintin et le temple de l’exception de parodie
Author:
teamtaomanews
L’artiste Xavier Marabout a réalisé des œuvres d’art mêlant l’univers du peintre Edward Hopper et celui de l’auteur de bande dessinée Hergé à travers la représentation du personnage de Tintin, placé dans des situations saugrenues. L’artiste a fait le choix de représenter le célèbre reporter accompagné de femmes dans des environnements austères, évoquant la mélancolie habituelle des œuvres de Hopper.
La société Moulinsart, titulaire exclusive des droits patrimoniaux de Hergé (à l’exception de l’édition des albums de bande dessinée) a constaté la vente et la commercialisation des œuvres, sur le site internet de Xavier Marabout, adaptant sans autorisation les personnages des Aventures de Tintin.
Cette dernière considérant ces actes comme contrefaisants a assigné Xavier Marabout en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire devant le Tribunal Judiciaire de Rennes (1).
La question principale abordée dans cette décision est de savoir si Xavier Marabout peut légitimement se prévaloir de l’exception de parodie. Et subsidiairement, s’il y a lieu de considérer que les actes en question sont parasitaires ou déloyaux.
Concernant la question de l’exception de parodie le Tribunal Judiciaire a rappelé le principe selon lequel lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire « 3° sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source ; 4° la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ».
Xavier Marabout invoque cette exception au monopole du droit d’auteur de la société Moulinsart, sans pour autant contester avoir reproduit et adapté sans autorisation des éléments issus des Aventures de Tintin.
Dans un premier temps, le tribunal s’est livré à une analyse précise de chaque critère de l’exception de parodie :
La parodie doit permettre l’identification immédiate de l’œuvre parodiée, ce qui est le cas en l’espèce puisque les personnages de l’œuvre d’origine sont aisément identifiables.
L’œuvre parodique doit se distinguer de l’œuvre originale. En l’espèce, le choix du support – un tableau versus une bande dessinée – permet bien de distinguer l’œuvre parodique de l’œuvre originale.
L’intention humoristique doit être présente et reconnue par le public, l’austérité des œuvres de Hopper est ici plus animée et vient transcender l’impossibilité pour Tintin d’afficher ses sentiments dans des situations burlesques où des femmes aux allures de « bimbos » sont représentées. En outre, le nom des œuvres permet également de démontrer l’approche parodique de l’auteur avec un effet humoristique tel que « Moulinsart au soleil» ou « Lune de miel » faisant écho directement aux œuvres originales de Hergé.
Une absence de risque de confusion : La parodie exige une distanciation comique et un travestissement qui ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux œuvres de l’auteur. Les Aventures de Tintin ont connu une diffusion mondiale considérable par le nombre d’exemplaires vendus, que le public identifie aisément. Les travestissements opérés sont effectués sous forme de tableau permettant de distinguer la représentation classique sous vignette de bande dessinée habituelle de Hergé. Enfin, les inspirations de l’univers de Hopper étant indéniables par les environnements reproduits mais aussi par les titres des œuvres ne peuvent venir caractériser un risque de confusion quelconque.
Dans ces conditions, le Tribunal judiciaire en conclut que les œuvres de Xavier Marabout traduisent une forme d’hommage et accueille l’exception de parodie.
Le tribunal s’est ensuite concentré sur le fait de savoir si la démarche de Xavier Marabout ne s’inscrivait pas dans une démarche purement commerciale et mercantile, s’appropriant ainsi la valeur économique de l’œuvre de Hergé, portant de ce fait atteinte aux droits patrimoniaux de la société Moulinsart.
Faisant une appréciation très concrète des enjeux financiers en comparant les revenus générés par l’œuvre de Hergé et ceux découlant de l’exploitation des tableaux de Xavier Marabout les juges considèrent que les faits allégués de contrefaçon n’engendrent qu’une perte financière minime voire totalement hypothétique pour la société Moulinsart, qui ne peut dès lors s’opposer à la liberté de création.
En conséquence, le Tribunal judiciaire déboute la société Moulinsart de ses demandes au titre du droit d’auteurs en excluant toute faute constitutive de contrefaçon.
Pour ce qui est des demandes en concurrence déloyale ; le tribunal a noté que l’exception de parodie ne peut venir caractériser un comportement fautif parasitaire et que les activités commerciales d’exploitation des produits dérivés de l’œuvre de Tintin par la société Moulinsart ne s’adressent pas à la même clientèle que les œuvres réalisées par Xavier Marabout, et ne peuvent de ce fait constituer une concurrence déloyale.
Ainsi, cette décision parait cohérente et mesurée, notamment au regard des œuvres en question où l’empreinte de l’auteur par l’originalité de ses choix et références permettent de faire prévaloir la liberté d’expression des artistes.
Dorian Souquet
Juriste stagiaire
Anne Laporte
Avocate à la Cour
(1) Tribunal judiciaire de Rennes, 2e chambre civile, 10 Mai 2021, 17/04478 – Société Moulinsart c/ Xavier Marabout
25
mars
2021
Un pacte d’actionnaires peut emporter cession de droits d’auteur
Author:
teamtaomanews
La question de la titularité du droit d’auteur sur les inventions de salariés est récurrente en droit français. Le principe est que l’existence d’un simple contrat de travail n’emporte aucune dérogation au profit de l’employeur à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l’auteur salarié. Ainsi, en l’absence de cession de droits, le salarié ne transmet à son employeur aucune autorisation d’exploitation sur ses œuvres. Mais les choses se compliquent lorsque le salarié est également actionnaire et qu’un pacte d’actionnaire envisageait le sort des œuvres à naître.
La cour d’appel a eu l’occasion de se pencher sur ce problème dans un arrêt du 26 février 2021 relatif à des créations de mode. Le conflit opposait d’une part une société CYMBELINE FOREVER, venant aux droits de la société CYMBELINE, spécialisée dans la commercialisation de robes de mariées, et d’autre part l’ancienne directrice de collection salariée de CYMBELINE, dont le contrat de travail avait trouvé son terme mais qui était toujours actionnaire.
L’ancienne directrice reprochait à la société qui avait repris le fonds de commerce d’avoir commercialisé cinq modèles de robes de mariées créés après la fin de son contrat de travail et dont elle n’avait cédé les droits à personne.
La cour a considéré que l’ancienne directrice de collection prouvait bien sa qualité d’auteur mais qu’elle avait cédé les droits d’exploitation à la société et ne pouvait invoquer une atteinte à ses droits patrimoniaux ; que toutefois l’absence de son nom avait porté atteinte à son droit moral.
Les juges commencent donc par reconnaitre la qualité d’auteur à l’ancienne directrice de collection et l’originalité de ses créations, ce qui justifie, en l’absence de la mention de son nom, une condamnation pour atteinte au droit moral. Ils considèrent ensuite que la titularité des droits patrimoniaux revient à la société CYMBELINE. Pour statuer ainsi, la cour constate que l’ancienne salariée avait signé, en compagnie des fondateurs, un pacte d’actionnaires prévoyant que la pleine propriété des droits de propriété intellectuelle appartenait à la société, mais également que chacun des signataires s’interdisait « à l’avenir de déposer ou de protéger de quelque façon que ce soit, à son nom, directement, indirectement ou par personne interposée, tous droits intellectuels (brevets, marques…) nécessaires ou utiles à l’activité de la Société ». Tout signataire s’engageait également « à déposer et protéger lesdits droits exclusivement au nom de la Société afin que cette dernière puisse en jouir et en disposer librement comme propriétaire ». Ce pacte ayant été conclu pour toute la durée pendant laquelle les signataires sont titulaires de titres et, en tout état de cause, pour une durée de douze années minimum, l’ancienne directrice n’était donc pas en mesure de revendiquer les droits sur ses créations puisqu’elle a « cédé à la société Cymbeline les droits patrimoniaux d’auteur » sur les robes litigieuses. L’ancienne salariée est déboutée de ses demandes à ce titre.
La Cour considère qu’un pacte d’actionnaires contenant un engagement de chacun des associés de ne pas revendiquer la protection de ses créations pour son propre compte vaut preuve de la cession des droits patrimoniaux.
Il s’agit là d’une solution intéressante et très discutable, selon laquelle l’interprétation de la volonté des parties semble devoir l’emporter sur les dispositions légales relatives à la nullité de la cession globale des œuvres futures (Code de la propriété intellectuelle, article L. 131-1) et à l’obligation de constatation par écrit et de façon précise des contrats de transmission des droits d’auteur (article L. 131-2, certes non applicable à la date des faits, et L. 131-3). En effet, si le droit français exige en principe que le contrat de cession énumère précisément les droits cédés et les modes d’exploitation couverts, les juges ont, en l’espèce, considéré que les stipulations relativement sommaires du pacte d’associés valaient transmission.
Une telle solution, qui pourrait donner matière à pourvoi en cassation, invite en tout cas les créateurs actionnaires à surveiller avec toujours plus de vigilance les droits dont ils sont propriétaires, afin d’être en mesure d’en conserver la maîtrise à travers le temps.
Référence et date : Cour d’appel de Paris, pôle 5 – ch. 2, 26 février 2021, n°19/15130
Décision non publiée, communiquée sur demande à contact-avocat@taoma-partners.fr
Retrouvez sous ce lien une autre actualité récente relative au droit de la mode et à la qualité d’auteur des salariés.
Jérémie LEROY-RINGUET
Avocat à la Cour
Mathilde GENESTE
Élève-avocate
23
mars
2021
Un employeur bien dans ses baskets de créateur
Author:
teamtaomanews
Selon une formule attribuée à Coco Chanel, « la mode se démode ; le style, jamais ». La mode se fait et se défait au gré des créations nouvelles. Les créateurs de ces réalisations ne se contentent pas de transformer des tissus en vêtements mais créent des objets qui ont un sens pour ceux qui les portent. Inspirée et créative, la mode n’est donc pas seulement une activité commerciale, mais une activité artistique à part entière, justifiant que les créateurs puissent être considérés comme des artistes.
Pour autant, la reconnaissance de la qualité d’auteur d’un styliste salarié n’est pas toujours évidente, notamment en cas de création collective. La Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de le rappeler dans un arrêt rendu le 5 mars 2021 opposant la société COMPTOIR DES COTONNIERS à l’un de ses salariés.
Le salarié en cause revendiquait la création, en septembre 2014, d’une paire de baskets vintage dénommée « Slash », de sa semelle léopard et de son sac d’emballage. Les juges de première instance l’ont déclaré irrecevable à agir au titre du droit d’auteur faute pour lui de justifier être à l’origine de la création.
En seconde instance, la Cour rappelle qu’il incombe à celui qui entend se prévaloir du droit d’auteur de rapporter la preuve d’une création déterminée à une date certaine et de caractériser l’originalité de la création – l’existence d’un contrat de travail n’étant pas exclusive de cette protection.
En l’occurrence, si le salarié prétend être, depuis son recrutement, le seul styliste de la société en charge des accessoires, les juges constatent que son contrat de travail le rattache à une équipe créative et à une directrice artistique.
La cour examine avec une grande précision les pièces, et notamment les attestations produites aux débats et en déduit que l’autonomie créatrice du salarié était restreinte et que, bien qu’il ait réalisé seul le croquis de la basket, il a agi « sous la subordination » de la directrice en charge de définir et de mettre en œuvre la ligne stylistique.
La Cour observe ensuite que la basket a été présentée dans la presse comme une création de la directrice de style, sans que le salarié ne s’y oppose et sans que celui-ci ne s’oppose non plus au dépôt par son employeur auprès de l’INPI d’une demande de protection au titre des dessins et modèles.
Toutes ces observations réunies, le salarié est déclaré irrecevable en son action en contrefaçon.
La Cour d’appel, sans pour autant énoncer une solution nouvelle, rappelle donc qu’un salarié qui prend part à un processus collectif de création sous la supervision d’une directrice artistique peut ne pas être en mesure de revendiquer la qualité d’auteur s’il ne justifie pas qu’il disposait de libertés de choix esthétiques et de création ne faisant pas l’objet de restrictions et d’encadrement en raison du contrôle d’un supérieur.
Les juges précisent ainsi les contours de la distinction essentielle qui existe entre le fait de participer à un processus créatif et celui de le maîtriser.
Cette question du cumul des qualités d’auteur et de salarié est source de nombreux contentieux depuis des décennies. La présente décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle qui restreint la possibilité pour des salariés d’obtenir la reconnaissance de leur qualité d’auteur et donc un complément de rémunération au titre de leurs droits patrimoniaux. Par exemple, dans l’arrêt Lavigne c. GIM (Cass. Soc. 19 oct. 2005, n°03-42.108) rendu en 2005 par la chambre sociale de la Cour de cassation, les juges avaient décidé d’appliquer la notion d’œuvre collective aux créations d’entreprise auxquels les salariés avaient participé et considéré que les droits issus de ces créations étaient nés directement sur la tête de l’entreprise – une qualification qui n’a toutefois pas été discutée dans l’arrêt commenté.
La jurisprudence invite donc à demeurer vigilant quant à la détermination au quotidien des droits des collaborateurs qui participent à des créations.
Référence et date : Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 5 mars 2021, n° 19/17254
Décision non publiée, communiquée sur demande à contact-avocat@taoma-partners.fr
Retrouvez sous ce lien une autre actualité récente relative au droit de la mode et à la qualité d’auteur des salariés.
Alain HAZAN
Avocat à la Cour – Associé
Mathilde GENESTE
Élève-Avocate
Load more
Loading...