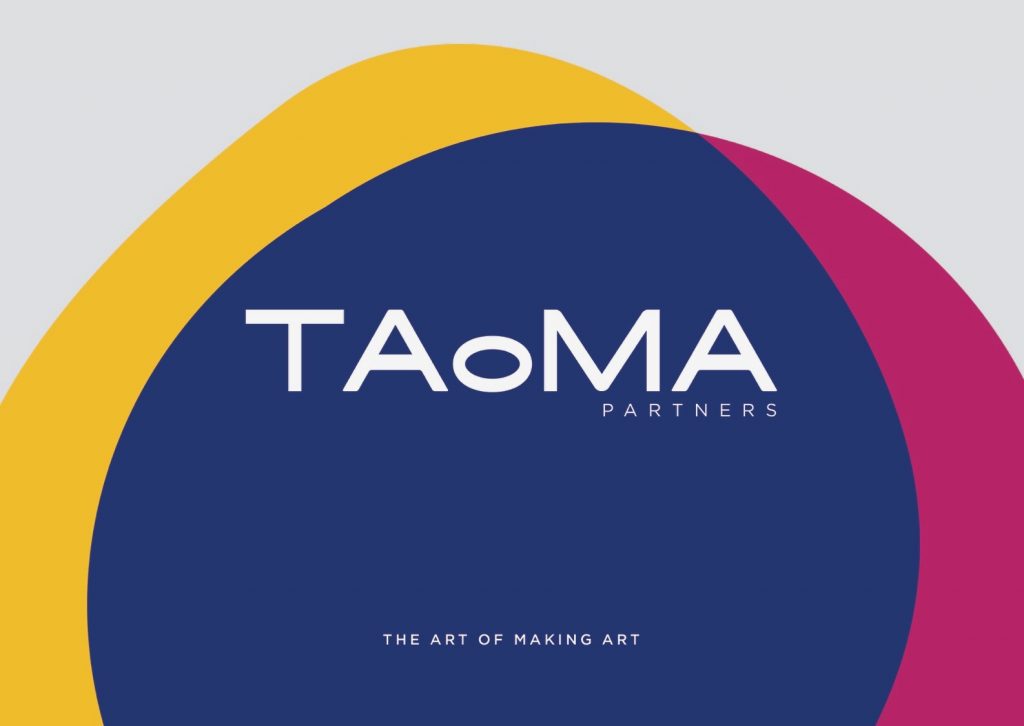29
août
2023
Anonymisation et liberté de la presse : Le droit à l’oubli numérique devant la Grande Chambre de la CEDH
Author:
TAoMA
En 1994, le quotidien belge Le Soir a publié un article relatant plusieurs accidents de voitures mortels survenus récemment, dont l’un causé par une personne sous l’emprise de l’alcool. Son nom complet figurait dans l’article. En 2008, cet article a été archivé numériquement sur le site internet du quotidien.
Condamné à une peine de prison avec sursis suite à cet accident puis ayant bénéficié d’une décision de réhabilitation, l’auteur de l’accident a demandé le retrait de l’article accessible en ligne au journal, car ses (potentiels) patients pouvaient y accéder en cherchant son nom sur les moteurs de recherche. Le quotidien a refusé cette suppression.
Face à ce refus, le demandeur a assigné l’éditeur du journal en justice au motif que cette information librement accessible présentait un risque pour la constitution et la conservation de sa patientèle. Le journal a été condamné civilement par les juridictions belges à anonymiser, au nom du droit à l’oubli et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, l’article archivé.
Droit à l’oubli contre liberté d’expression et liberté de la presse
Contestant sa condamnation, l’éditeur du journal a alors saisi la Cour européenne des droits de l’Homme, en invoquant l’article 10 de la Convention qui protège la liberté d’expression et la liberté de la presse. Le requérant estimait que cette condamnation constituait “une ingérence qui n’était pas nécessaire dans une société démocratique”.
La Cour s’est prononcée le 04 juillet 20231 et constate que s’il y a bien une ingérence dans l’exercice des droits invoqués et protégés par l’article 10, les juridictions nationales ont procédé à une mise en balance des intérêts en présence. Ce faisant cette ingérence a été réduite au minimum en se résumant à une anonymisation de l’article “et peut passer pour nécessaire dans une société démocratique et proportionnée”.
La condamnation à anonymiser l’article ancien, dénué d’actualité, d’élément historique ou scientifique, et ne concernant pas une personne ayant une certaine notoriété, est ainsi la mesure la plus appropriée selon la Grande Chambre de la Cour. Elle vient préciser que cette notoriété doit s’apprécier au regard des circonstances de l’espèce en se plaçant à la date de la demande de droit à l’oubli. En l’espèce, le demandeur n’était aucunement connu, sa profession (médecin) était sans conséquence sur une possible notoriété, et l’affaire le concernant n’avait eu aucune résonance à l’époque des faits. Il s’était également écoulé plus de 20 ans entre la parution de l’article et la demande de retrait.
Le numérique a apporté la permanence de l’information accessible sur Internet
Au regard du temps écoulé, laisser l’article en accès libre avec le nom complet de l’auteur de l’accident contribuait à “créer un casier judiciaire virtuel”. Il y avait donc un risque de préjudice pour l’auteur de l’accident. Il suffisait de saisir son nom sur le moteur de recherche du site internet du journal pour que l’article apparaisse en première page (bien qu’en sixième position), en plus d’être référencé en tant que premier résultat sur Google. Par ailleurs, l’article archivé pouvait être consulté gratuitement.
Les acteurs de la presse doivent donc trouver un équilibre entre la création d’archives numériques, qui jouent un rôle dans la pérennisation de l’information, et le droit à l’oubli numérique qui, n’étant pas un droit autonome, se rattache à l’article 8 de la Convention et plus particulièrement au droit au respect de la réputation, et qui “ne peut concerner que certaines situations ou informations” selon la Cour. Ce peut être le cas des données sensibles (données de santé, orientation sexuelle…), pénales (tel qu’un casier judiciaire) ou relevant de la vie privée, si leur conservation n’apparait plus pertinente au regard du temps écoulé. Et ce en « l’absence d’actualité ou d’intérêt historique ou scientifique » de l’article de presse, ainsi qu’en l’absence de notoriété de la personne concernée.
Cette mise en balance des intérêts doit en outre inclure la question de l’accessibilité des archives, selon qu’elles soient mises en accès libre et gratuit ou restreintes sous la forme d’une consultation par abonnement. Et cela même si la consultation d’archives implique en principe une démarche positive de l’utilisateur souhaitant en prendre connaissance.
La Cour européenne des droits de l’Homme opère donc la mise en balance entre le droit à l’oubli numérique, qui relève du droit au respect de la vie privée et est à ce titre protégé par l’article 8 de la CEDH, et la préservation de l’intégrité des archives numériques de presse en vertu de la protection de la liberté d’expression.
Arthur Burger
Stagiaire juriste
Malaurie Pantalacci
Conseil en Propriété Industrielle associée
(1) https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-225546
08
octobre
2019
Publication de la mauvaise photo : atteinte à la vie privée et non diffamation
Author:
teamtaomanews
Dans un arrêt rendu le 12 septembre 2019 dont la solution est classique, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé l’interprétation stricte des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en matière de qualification des faits et de prescription applicable.
L’arrêt oppose une personne physique, M. Farid Z, à la société détentrice du quotidien Sud-Ouest. M. Z reprochait à la publication d’avoir utilisé une photographie de sa personne pour illustrer un article publié en ligne et concernant M. Riyad K, suspecté de participation à un projet terroriste.
Après que la société a reconnu que la photographie avait été publiée par erreur, elle a été condamnée en appel sur le fondement de l’article 9 du Code civil invoqué par la partie demanderesse et qui entend protéger le respect de la vie privée en permettant au juge de « prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ».
Dans le pourvoi, la société estime que le juge du fond aurait dû opérer une requalification du fondement et maintient que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la diffamation et à son régime dérogatoire du droit commun auraient dû s’appliquer. Selon elle, en effet, les faits relevaient de la qualification de diffamation laquelle est caractérisée par « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne (…) » commis par voie de la presse ou tout autre moyen de publication (article 29 de la loi de 1881). Cette requalification aurait eu pour effet de rendre l’action de M. Z prescrite par le délai de trois mois prévu à l’article 65 de la loi précitée.
La demanderesse au pourvoi considérait donc que la Cour d’appel s’était contredite dans ses motifs. En effet, il lui était reproché de ne pas avoir retenu la qualification de diffamation pour la simple raison, selon la cour, que le plaignant n’était pas identifiable sur la photographie et qu’elle ne saurait être diffamée en raison de propos tenus au sujet d’une autre personne, tout en lui ayant octroyé des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 9 du Code civil, « au regard du préjudice moral pouvant résulter du fait d’être assimilé à M. K. compte tenu des faits alors imputés à celui-ci, dans la mesure où il était parfaitement identifiable par son entourage familial, social et professionnel ».
Néanmoins, la haute juridiction a confirmé l’arrêt de la cour d’appel retenant la qualification d’atteinte à la vie privée et rejetant par conséquent l’application du régime de prescription trimestrielle du droit de la presse.
En effet, il n’y a diffamation que si le particulier est visé, ou mentionné, de manière directe ou identifiable. L’atteinte à la personne étant, par définition, strictement personnelle, seule la personne visée a qualité à agir en diffamation. Cependant, il est important de mentionner que l’article 29 de la loi sur la liberté de la presse dispose que l’action en diffamation peut être ouverte « même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes » utilisés. La jurisprudence a déterminé qu’il est à la charge de la victime de démontrer qu’elle est identifiable dans la publication par ses proches ou par un « cercle restreint d’initiés » (Cass. Crim., 15 nov. 2016, n°15-87241).
En l’espèce, le juge du fond a retenu à bon droit que, si la photographie de M. Z était incluse dans l’article, il n’était fait nulle mention du nom du requérant et l’article ne lui imputait aucun des faits litigieux. Dès lors, la Cour exclut la qualification de diffamation et en conclut que le régime dérogatoire en matière de prescription n’avait pas à s’appliquer.
Rappelons enfin que cet arrêt, s’il ne fait que confirmer une interprétation stricte et bien connue de la loi sur la presse, est rendu dans un contexte mouvementé. Alors que, sous le précédent quinquennat, il avait été question de sortir de la loi de 1881 toutes les dispositions relatives au racisme, ce sont précisément celles relatives à l’injure et à la diffamation qui aurait pu s’en émanciper si le projet de la Garde des sceaux, vivement contesté, n’avait été finalement enterré par le Premier ministre à l’été 2019. La loi de 1881 résiste, encore et toujours…
Willems Guiriaboye
Stagiaire
Jérémie Leroy-Ringuet
Avocat
Cour de cassation, 1e chambre civile, 12 Septembre 2019 – n°18-23108
Décision non publiée, communiquée sur demande à contact@taoma-partners.fr
28
juin
2019
Parodie : Le Point fait rire la Cour de cassation
Author:
teamtaomanews
Le 19 juin 2014, le journal Le Point publiait un numéro dont la Une représentait, sous l’intitulé « Corporatiste intouchables, tueurs de réforme, lepéno-cégétistes… Les naufrageurs – la France coule, ce n’est pas leur problème », un buste de Marianne à demi submergé.
Il est cependant apparu que le journal n’avait pas recherché l’autorisation de l’auteur de la sculpture apparaissant dans ce photomontage, Alain Gourdon, dit Aslan, avant de procéder à la publication. Le sculpteur étant décédé, son épouse (investie de l’ensemble de ses droits) a assigné le Point en contrefaçon. Après le rejet de sa demande par les juges du fond, c’est la Cour de Cassation qui, par un arrêt du 22 mai 2019, a définitivement mis fin aux prétentions de la demanderesse.
Dans sa décision, la Cour marque son accord avec la qualification de parodie donnée à la Une de l’hebdomadaire par la cour d’appel. En effet, l’article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle indique que « lorsqu’une œuvre est divulguée, l’auteur ne peut interdire […] 4° la parodie, le pastiche ou la caricature, compte tenu des lois du genre », ces dernières n’étant pas définies légalement.
La Cour de Justice de l’Union Européenne[1] avait déjà apporté un éclairage sur les caractéristiques que devaient présenter une œuvre pour pouvoir être considérée comme une parodie, à savoir :
Évoquer une œuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci ;
Constituer une manifestation d’humour ou une raillerie.
En revanche, elle avait souligné que la notion de « parodie » n’était pas soumise à des conditions selon lesquelles elle devrait présenter un caractère original propre, pouvoir raisonnablement être attribuée à une personne autre que l’auteur de l’œuvre originale, porter sur l’œuvre originale ou mentionner la source de l’œuvre parodiée.
S’agissant d’une notion autonome du droit de l’Union, c’est à la lumière de cette interprétation que la Cour de cassation s’est prononcée, validant la décision de la cour d’appel, qui avait relevé :
L’absence de tout risque de confusion avec l’œuvre originale, du fait des éléments propres ajoutés par le photomontage ;
L’existence d’une « métaphore humoristique du naufrage prétendu de la République » qui résultait dudit montage, peu important le caractère sérieux de l’article qu’il illustrait,
Sans chercher à savoir, en revanche, si la parodie portait sur l’œuvre elle-même, ce critère ayant été écarté par la CJUE.
Date et référence : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-12718
Lire la décision complète sur Legifrance
[1] CJUE, 3 septembre 2014, Deckym, C-201/13
31
mai
2019
Pas de qualification de « fake news » pour le tweet de Christophe Castaner
Author:
teamtaomanews
La loi relative à la manipulation de l’information, publiée au journal officiel du 23 décembre 2018, avait pour objectif d’éviter une recrudescence de fausses informations à l’approche des élections européennes.
Cette disposition très spécifique au contexte électoral a été mise à l’épreuve récemment dans un jugement rendu « en état de référé » par la formation collégiale de référé du Tribunal de grande instance de Paris (au visa de l’article 487 du Code de procédure civile).
Ce jugement du 17 mai 2019 refuse d’ordonner de faire cesser la diffusion d’un tweet controversé, publié par Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, à la suite des événements ayant eu lieu à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière en marge des manifestations du 1ermai.
Le tweet en question est rédigé en ces termes :
« Ici à la Pitié-Salpêtrière, on a attaqué un hôpital.
On a agressé son personnel soignant. Et on a blessé un policier mobilisé pour le protéger.
Indéfectible soutien à nos forces de l’ordre : elles sont la fierté de la République ».
Pour les deux plaignants, des parlementaires membres du Parti communiste français, ce post constituait une allégation inexacte et trompeuse au sens de l’article L. 163-2 du Code électoral et devait être retiré par le réseau à l’oiseau bleu.
Selon ce texte, « Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, lorsque des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d’un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d’un service de communication au public en ligne, le juge des référés peut, à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir, et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire aux personnes physiques ou morales mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion. »
Il revenait donc au juge des référés d’apprécier le contenu du tweet incriminé afin de décider ou non de sa suppression. Ce dernier, après avoir mis hors de cause Twitter France et reçu les interventions de Twitter International et du ministre, a, pour justifier son refus, interprété le texte en accord avec la décision rendue à son sujet par le Conseil constitutionnel le 20 décembre 2018, qui dégageait les critères permettant d’identifier une fake news illicite.
Or le jugement considère que ces critères ne sont pas réunis :
Les propos du ministre apparaissent exagérés (pas d’attaque) mais portent sur des faits réels confirmés, à savoir l’intrusion de manifestants dans l’établissement le 1ermai 2019. Ainsi, l’information ne saurait être considérée comme dénuée de tout lien avec le réel, ce qui l’empêche d’être considérée comme manifestement inexacte ou trompeuse
Les propos n’ont pas été diffusés d’une manière « cumulativement massive, artificielle ou automatisée, et délibérée » notamment par des robots pour le compte de tiers désireux de répandre la fausse nouvelle. Ce critère, interprété à la lumière de l’exposé des motifs de la proposition de loi sur la lutte contre la manipulation de l’information, renvoie selon lui à l’usage de tiers rémunérés pour la diffusion de l’information, ou de « bots » permettant une quantité massive et automatique de retweets
Enfin, appréciant le risque manifeste d’altération de la sincérité du scrutin, le juge rejette l’argument des demandeurs selon lequel le tweet incriminé, en « faisant croire à un climat de violence pour faire jouer le ressort de la peur et du chaos », aurait un effet manifeste sur la campagne européenne en cours au moment des faits. Selon lui, l’immédiate contestation des propos du ministre par différents articles de presse offrait à l’électeur une pluralité de points de vue sur les événements, le mettant à l’abri de toute manipulation
Au vu de ces trois critères, la demande de retrait est donc rejetée.
Ce jugement offre un regard intéressant sur l’application de la loi « fake news » par nos juridictions et sur le caractère très restrictif de ses conditions d’applications. L’usage de moyens automatisés, ou l’absence de tous liens avec la réalité, ne permettent ainsi au texte que de cibler les plus extravagantes des fausses informations dans un contexte de manipulation de l’opinion publique.
Pour d’autres types de propos mensongers, d’autres textes seront éventuellement applicables : ceux sur la diffamation et ceux sur la dénonciation calomnieuse, ou encore l’article 27 de la loi du 29 juillet 1881 qui continue de réprimer « la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler ».
Lire la décision complète