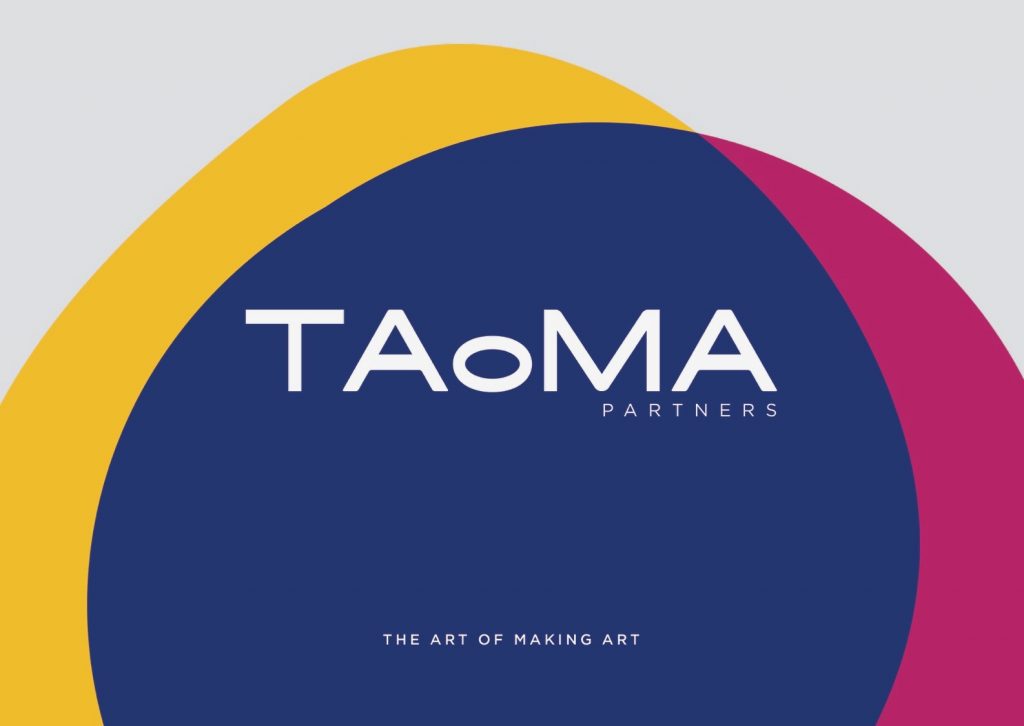26
mars
2024
Saga CASTELBAJAC : la cession de marque patronymique n’excluerait donc pas le « contrôle » de son usage a posteriori ?
Author:
TAoMA
Une nouvelle décision a été rendue le 28 février 2024 par les juges de la Cour de Cassation1.
En question notamment, la recevabilité d’une action en déchéance contre une marque patronymique cédée, initiée par le cédant, qui n’est autre que l’artiste de renom Monsieur Jean Charles de Castelbajac.
Des éléments de contexte s’imposent.
Monsieur Jean Charles de Castelbajac s’est démuni de ses marques patronymiques (et notamment de ses marques françaises JC DE CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC) à l’occasion d’un acte de cession au profit de la société PMJC en 2012. Cette cession intervenait à la suite d’une offre de reprise de la totalité des actifs corporels et incorporels de la société du cédant, à la barre du tribunal.
En parallèle, un protocole de prestation de services a été conclu entre les protagonistes par lequel Monsieur JC de Castelbajac assurait des missions de directeur artistique au profit de la société PMJC, et dans lequel il était question de la « nécessaire adéquation entre l’image des marques et des articles commercialisés avec l’image » de l’artiste.
Au terme dudit protocole, en décembre 2015, les relations se sont toutefois dégradées.
La société PMJC reprochait à Monsieur de Castelbajac des faits de concurrence déloyale et d’atteinte à ses marques. Pour cause, l’artiste était à l’origine d’une nouvelle société de création, de conseil et de direction artistique, reprenant son nom. Il fera donc l’objet d’action en contrefaçon des marques de la société PMJC, portant (pourtant) son nom.
A titre de riposte, Monsieur de Castelbajac accuse la société PMJC d’imitation de son univers et de ses œuvres et d’adaptation non autorisée de ces dernières. Il tente alors de faire tomber les marques adverses pour déceptivité en raison des usages, selon lui, trompeurs que leur nouveau titulaire en a faits.
En 2016, le conflit judiciaire s’installe.
Le cédant peut il agir contre le cessionnaire des marques portant son nom ?
L’une des questions principales de ce conflit est celle de la recevabilité d’une action en déchéance pour déceptivité contre une marque patronymique, introduite par le cédant éponyme contre le cessionnaire, nouveau titulaire exploitant.
En effet, une telle action a été reconnue recevable, de manière inédite par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 12 octobre 20222. A cette occasion, les juges avaient également annulé les marques françaises attaquées JC DE CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC pour déceptivité.
La société PMJC a ensuite introduit un pourvoi en Cassation en soutenant que Jean Charles de Castelbajac n’était pas recevable à agir en ce qu’il ne pouvait engager d’action ayant pour finalité de l’évincer en tant qu’acquéreur des marques.
Jusqu’alors, les défenseurs de ce type d’action invoquait la garantie d’éviction, principe classique du droit des contrats.
Cette garantie d’éviction est l’assurance de l’acquéreur de posséder la marque acquise une fois la cession effective. Ainsi, en application de cette garantie, le cédant de la marque ne peut troubler la jouissance du cessionnaire. Il ne peut notamment agir en justice pour demander l’annulation de la marque qu’il a cédé.
Rappelons ici deux arrêts de référence en matière de marque patronymique au visa desquelles les juridictions françaises statuaient jusqu’alors dans ce type d’affaire.
La Cour de Cassation a rendu le 31 janvier 20063 au sujet des marques Ines de la Fressange, un arrêt sans équivoque : « Mme de La Fressange, cédante, n’était pas recevable en une action tendant à l’éviction de l’acquéreur ». En considérant l’action irrecevable, la Cour de cassation n’avait donc pas eu à statuer sur le caractère déchéable des marques patronymiques en cause.
Faisant suite à une question préjudicielle qui lui était posée, la CJCE a quant à elle considéré, dans un arrêt « Elizabeth Florence Emanuel » en date du 30 mars 20064, :
– d’une part, que la seule présence du nom de famille d’un créateur et premier fabriquant des produits, au sein d’une marque était insuffisante pour caractériser une tromperie, et donc pour justifier la déchéance, même si ladite personne n’avait plus de lien avec la société titulaire de la marque ;
– d’autre part, le fait que la société puisse faire croire que le créateur était toujours actif au sein de la société était certes constitutif d’une manœuvre dolosive, mais pas d’une tromperie de nature à justifier une déchéance.
La Cour de Cassation change de cap.
Aussi, dans sa dernière décision en date du 28 février 2024, la Cour de Cassation crée une rupture avec la position européenne.
La Cour rappelle d’abord que la garantie d’éviction dont bénéficie le cessionnaire empêche tout cédant d’agir contre le premier si cette action a pour finalité de l’évincer de la chose vendue. Elle nuance toutefois son propos en se ralliant à l’interprétation contestée de la Cour d’appel de Paris et retient que « la garantie au profit de cessionnaire cesse lorsque l’éviction est due à sa faute ».
En d’autres termes, l’action en déchéance du cédant reste ouverte en cas de faute du cessionnaire, lorsqu’il est à l’origine même de sa propre éviction.
La Cour rappelle ensuite que le maintien des droits sur une marque suppose que son usage ne soit pas « de nature à tromper effectivement le public ou à créer un risque grave de tromperie », pour conclure que désormais, l’exception à la garantie d’éviction contre une action en déchéance d’une marque patronymique est constituée quand cette action est fondée sur la « survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire ».
L’appréciation de la déchéance pour usage deceptif renvoyée vers les instances européennes
Au sujet même de la constitution de la déchance, la Cour de Cassation va maintenir le suspense en posant la question préjudicielle suivante à la CJUE :
« Les articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques et 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du nom de famille d’un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que ce créateur participe toujours à la création des produits marqués alors que tel n’est plus le cas ? »
En d’autres termes, les juridictions doivent-elles rejeter la déchéance d’une marque patronymique cédée si les conditions de son usage postérieur à la vente sont de nature à faire croire que le cédant créateur éponyme participe toujours à la création des produits marqués, alors qu’il en est étranger ?
Toute l’attention est désormais concentrée vers la réponse qu’apporteront les juges européens à la question préjudicielle formulée pendant dans cette affaire. Il y a fort à espérer que la CJUE apporte quelques éclairages necessaires sur les sujets et questions complexes que pose cette saga qui semble interminable.
Mazélie PILLET
Conseil en Propriété Industrielle
1) Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 28 février 2024, n° 22-23.833
2) Cour d’appel de Paris, 12 octobre 2022, N° 20/11628
3) Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 janvier 2006, n° 05-10.116, Publié au bulletin
4) CJCE, n° C-259/04, Arrêt de la Cour, Elizabeth Florence Emanuel contre Continental Shelf 128 Ltd, 30 mars 2006
27
janvier
2021
Opérations promotionnelles et boissons alcoolisées, une navigation en eaux troubles…
Author:
teamtaomanews
Il y a bientôt dix ans, la Cour de cassation faisait sensation en décidant, dans une célèbre décision « Ricard », que le partage, par des abonnés Facebook, de messages générés par une application pouvait constituer de la publicité en faveur de boissons alcooliques.
Plus récemment, la cour d’appel de Paris est venue apporter des précisions sur ce qui doit être considéré comme entrant dans la définition de ces publicités, par ailleurs strictement encadrées par le Code de la santé publique.
Une société exploitant des casinos a confié à une agence de publicité le soin de réaliser son programme de fidélité et des actions de création de trafic et d’animation de ses établissements de jeu. Pour ce faire, une campagne promotionnelle a été lancée, comportant :
Une loterie commerciale intitulée « Champagne à vie » dont le lot principal était une bouteille par mois à vie de champagne de la marque Pommery,
Une opération promotionnelle concomitante intitulée « 2 coupes de champagne + 10 euros de jetons pour 10 euros seulement ».
La publicité de ces opérations était effectuée sur :
Le site champagneavie.com, créé pour l’occasion,
Les pages Facebook des casinos concernés,
Le journal Directmatin, notamment disponible en ligne (édité par la société Bolloré Digital Média).
L’Association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie (ANPAA) a assigné l’ensemble des parties prenantes (les sociétés du groupe Pommery fournissant le champagne, la société exploitant les casinos, l’agence de communication ayant conçu la campagne et la société Bolloré Digital Média l’ayant relayée), faisant valoir que ces publications constituaient de la publicité illicite en faveur de la boisson alcoolique Champagne Pommery ainsi qu’un parrainage illicite de jeu.
Après de nombreux débats en première instance sur le partage de responsabilité des parties ainsi que sur la valeur du constat d’huissier, l’ANPAA a porté l’affaire devant la cour d’appel de Paris, auprès de laquelle elle conteste :
1- La licéité du visuel faisant la promotion de l’opération, qui contiendrait des mentions qui ne sont pas expressément autorisées le Code de la santé publique, à savoir :
La présence de jetons de casino,
Les mentions « 10 euros de jetons et pour 10 euros seulement » et « champagne à vie » et le nom du casino,
L’illustration de verres en train de trinquer.
Elle critique en outre ce qu’elle qualifie d’invitation à la pratique du jeu sous l’emprise de l’alcool, de nature à susciter une perte de contrôle, prétendant notamment que la jurisprudence sanctionnerait l’association d’éléments liés aux jeu de hasard aux boissons alcooliques et dénonce le fait que les deux coupes de champagne seraient en réalité offertes.
2- La licéité du jeu concours « Champagne à vie » qui constituerait a minima une publicité indirecte pour de l’alcool ne respectant pas les dispositions relatives à ce type de communication et dont le lot lui-même contribuerait à banaliser une consommation déraisonnée et excessive de l’alcool.
3- La présence sur le site Internet champagneavie.com du visuel contesté accompagné du slogan« tout pétille encore plus dans les casinos D. »
4- La présence sur les pages Facebook des casinos concernés de publications constituant des publicités illicites pour des boissons alcooliques en raison de l’utilisation de la marque Pommery et de l’évocation de la boisson vendue sous cette marque, à savoir du champagne.
La cour commence son raisonnement en rappelant les règles strictes issues du Code de la santé publique encadrant la publicité, directe ou indirecte, pour les boissons alcooliques, à savoir, en substance :
Les supports autorisés (presse écrite hors jeunesse, offre d’objets strictement réservés à la consommation d’alcool marqués au nom des fabricants, services de communication en ligne hors jeunesse et associations sportives, etc.) ;
L’interdiction des opérations de parrainage ;
Les mentions autorisées (degré volumique d’alcool, origine, dénomination, modalités de vente et de consommation du produit, référence aux terroirs, etc.) ;
L’obligation d’accompagner la publicité d’un message sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Appliquant ces règles :
1- Elle estime que le visuel litigieux constitue une publicité illicite.
En effet, la campagne promotionnelle a pour finalité de promouvoir les établissements de jeux concernés et de créer un courant de clientèle par le biais d’offres attractives inhérentes à la démarche publicitaire. Bien qu’elle ne soit donc pas assimilable à une offre de consommation d’alcool gratuite, elle s’apparente bien à de la publicité incitant à la consommation d’une boisson alcoolique, ce que les défenderesses ne pouvaient pas nier puisqu’elles avaient intégré l’avertissement sanitaire imposé par le Code de la santé publique.
Ainsi, ses composants doivent être analysés à la lumière des dispositions dudit Code :
La présentation flatteuse du produit par la mise en valeur de sa couleur et de sa pétillance (sic), la référence à son mode de consommation par l’inclinaison des coupes qui miment le geste de trinquerrenvoient aux caractéristiques objectives du produit et un mode de consommation coutumier et ne peuvent donc pas être critiquées ;
Par contre, la présence des jetons de jeu excède les prévisions du Code qui limitent la communication au produit et son environnement.
2- En revanche, concernant l’opération elle-même, la cour souligne que seule la communication autour de l’opération est soumise au régime légal des publicités en faveur des boissons alcooliques, le jeu lui-même étant soumis aux dispositions du Code de la consommation, qui n’interdit nullement l’offre de champagne en tant que lot.
3- Concernant la présence des visuels litigieux sur le site disponible à l’adresse champagneavie.com, la cour relève qu’il s’ouvre sur un visuel quasi-identique à celui déjà reconnu illicite, caractère accentué par le fait que le slogan « tout pétille encore plus dans les casinos D. » prête à l’établissement une des qualités du vin vendu – son pétillement. Ainsi, ces images sont également illicites.
4- Enfin, à propos des publications sur les pages Facebook des casinos concernés, la cour raisonne en plusieurs temps :
L’annonce de l’opération « champagne à vie » (« Préparez-vous à pétiller. Rendez-vous dans votre casino D pour tenter de remporter du champagne offert chaque mois à vie. Pour en savoir plus et trouver votre casino, cliquez ici : […] Votre bouteille de champagne offerte chaque mois à vie », le tout sans la moindre référence à une marque de commerce d’une boisson alcoolisée) ne constitue qu’une invitation à participer à la loterie, ce qui est licite.
De même, l’annonce d’une « offre découverte » comportant la mention « – 20% sur la 2e place pour le même spectacle + 5 euros de jetons + 2 coupes de champagne », le tout encadré à gauche du dessin de jeton et à droite de deux verres de champagne (qui trinquent), sans la moindre mention de marque de commerce de boissons alcooliques a pour finalité d’inciter les internautes à acquérir une place de spectacle et ne constitue nullement une publicité pour le vin de champagne. Elle n’avait donc pas à être accompagnée d’une mention sanitaire.
Enfin, s’agissant de l’annonce des gagnants de la loterie, une distinction est faite entre :
Le texte de l’annonce « félicitation aux heureux gagnants de notre grand jeu concours Champagne à vie, merci à toutes et à tous pour votre participation. A très bientôt, dimanche, ne ratez pas le tirage au sort de notre jeu champagne à vie. Gagnez en exclusivité ce Jéroboam Silver Pop produit en édition limitée, plus que 3 jours pour tenter de remporter du champagne offert à vie. Rendez-vous dimanche dans votre Casino D pour découvrir si vous avez gagné […] » => dès lors que la loterie ne constitue pas en elle-même un support interdit, l’emploi de ces termes n’était pas interdit.
Les photographies représentant des bouteilles de champagne de marque Pommery sur un présentoir à étage / quatre gagnants posant à côté d’une bouteille et d’un carton, lesquels portent ladite marque / et un jéroboam de champagne Pop de marque Pommery entouré de deux bouteilles de ce même produit d’une contenance moindre => chacune de ces images, sur lesquelles figure le conditionnement de boissons alcooliques, constitue une publicité pour celle-ci et devait, dès lors, comporter un message sanitaire.
Que retenir ? S’il n’est pas exclu que cette décision fasse l’objet d’un pourvoi en cassation, elle permet d’illustrer l’extrême granularité dont font preuve les juridictions dans l’appréciation de l’illicéité des opérations promotionnelles impliquant de l’alcool, faisant notamment une distinction entre l’objet de la campagne (qui peut être une boisson alcoolisée) et le support de cette campagne (qui doit répondre aux exigences strictes du Code de la santé).
Une grande prudence doit donc être de mise !
Anita Delaage
Avocate
Référence et date : Cour d’appel de Paris, Pôle 2 – chambre 2, 3 décembre 2020, n° 18/15699
Décision non publiée, communiquée sur demande à contact-avocat@taoma-partners.fr
16
octobre
2019
AOP : L’habit fait-il le fromage ?
Author:
teamtaomanews
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 19 juin 2019 [1], a posé une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) en matière d’Appellation d’Origine Protégée (AOP) afin de savoir si la reprise des caractéristiques physiques d’un produit protégé par une AOP peut constituer une pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
Le « Morbier » est un fromage qui bénéficie d’une AOP. Le décret ayant instauré l’appellation « Morbier » le décrit notamment comme « un fromage […] de la forme de cylindre plat […] qui présente des faces planes et un talon légèrement convexe. […] La pâte est de couleur ivoire à jaune pâle avec éventuellement une raie noire centrale horizontale […] ». Une photo sera bien plus parlante :
Une société fromagère, hors de la zone géographique de l’AOP, produit un fromage dont l’apparence visuelle est identique à celle du « Morbier ».
L’organisme de Défense et de Gestion (ODG) de l’AOP « Morbier » en fait donc tout un fromage et assigne en justice cette société au motif qu’elle porte atteinte à l’AOP et commet des actes de concurrence déloyale et parasitaires du fait de la fabrication et de la commercialisation de son fromage ayant l’apparence du « Morbier ». La société fromagère créerait la confusion avec le « Morbier » et profiterait de sa notoriété.
Aussi bien le Tribunal de Grande Instance que la Cour d’Appel de Paris ont rejeté les demandes de l’ODG nous menant devant la Cour de Cassation.
La présente affaire repose en effet sur l’interprétation de l’article 13, §1 du Règlement n°1151/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 21 Novembre 2012 relatif aux systèmes de qualités applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires qui énumère les actes interdits contre les AOP comme suit :
« 1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre : […]
d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. »
Si la protection accordée par le point d) de cet article semble large, il n’en demeure pas moins que le texte fait expressément référence à la « dénomination protégée ». Cela signifie-t-il que seul le nom « Morbier » est protégé par les textes européens ou ceux-ci doivent-ils être interprétés de manière plus large, comme interdisant également la reprise de la présentation visuelle du produit ?
Pour le Tribunal de Grande Instance et la Cour d’Appel, seule la dénomination « Morbier » est protégée. Mais la Cour de Cassation n’en est pas aussi sûre estimant que cette question est inédite et que la CJUE « ne semble pas avoir rendu de décision sur la question […] ».
Le décret ayant instauré l’appellation « Morbier » contenant des prescriptions claires et précises sur la forme caractéristique du fromage, la Cour de Cassation estime qu’il existe un doute sur l’interprétation du point d) de l’article 13 §1 et en appel donc au jugement de la CJUE.
L’habit fait-il le fromage et surtout l’AOP ? La CJUE devra en répondre dans les prochains mois ! Affaire à suivre…
Jean-Charles Nicollet
Conseil en Propriété Industrielle
[1] Lien vers la décision
08
octobre
2019
Publication de la mauvaise photo : atteinte à la vie privée et non diffamation
Author:
teamtaomanews
Dans un arrêt rendu le 12 septembre 2019 dont la solution est classique, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé l’interprétation stricte des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en matière de qualification des faits et de prescription applicable.
L’arrêt oppose une personne physique, M. Farid Z, à la société détentrice du quotidien Sud-Ouest. M. Z reprochait à la publication d’avoir utilisé une photographie de sa personne pour illustrer un article publié en ligne et concernant M. Riyad K, suspecté de participation à un projet terroriste.
Après que la société a reconnu que la photographie avait été publiée par erreur, elle a été condamnée en appel sur le fondement de l’article 9 du Code civil invoqué par la partie demanderesse et qui entend protéger le respect de la vie privée en permettant au juge de « prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ».
Dans le pourvoi, la société estime que le juge du fond aurait dû opérer une requalification du fondement et maintient que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la diffamation et à son régime dérogatoire du droit commun auraient dû s’appliquer. Selon elle, en effet, les faits relevaient de la qualification de diffamation laquelle est caractérisée par « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne (…) » commis par voie de la presse ou tout autre moyen de publication (article 29 de la loi de 1881). Cette requalification aurait eu pour effet de rendre l’action de M. Z prescrite par le délai de trois mois prévu à l’article 65 de la loi précitée.
La demanderesse au pourvoi considérait donc que la Cour d’appel s’était contredite dans ses motifs. En effet, il lui était reproché de ne pas avoir retenu la qualification de diffamation pour la simple raison, selon la cour, que le plaignant n’était pas identifiable sur la photographie et qu’elle ne saurait être diffamée en raison de propos tenus au sujet d’une autre personne, tout en lui ayant octroyé des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 9 du Code civil, « au regard du préjudice moral pouvant résulter du fait d’être assimilé à M. K. compte tenu des faits alors imputés à celui-ci, dans la mesure où il était parfaitement identifiable par son entourage familial, social et professionnel ».
Néanmoins, la haute juridiction a confirmé l’arrêt de la cour d’appel retenant la qualification d’atteinte à la vie privée et rejetant par conséquent l’application du régime de prescription trimestrielle du droit de la presse.
En effet, il n’y a diffamation que si le particulier est visé, ou mentionné, de manière directe ou identifiable. L’atteinte à la personne étant, par définition, strictement personnelle, seule la personne visée a qualité à agir en diffamation. Cependant, il est important de mentionner que l’article 29 de la loi sur la liberté de la presse dispose que l’action en diffamation peut être ouverte « même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes » utilisés. La jurisprudence a déterminé qu’il est à la charge de la victime de démontrer qu’elle est identifiable dans la publication par ses proches ou par un « cercle restreint d’initiés » (Cass. Crim., 15 nov. 2016, n°15-87241).
En l’espèce, le juge du fond a retenu à bon droit que, si la photographie de M. Z était incluse dans l’article, il n’était fait nulle mention du nom du requérant et l’article ne lui imputait aucun des faits litigieux. Dès lors, la Cour exclut la qualification de diffamation et en conclut que le régime dérogatoire en matière de prescription n’avait pas à s’appliquer.
Rappelons enfin que cet arrêt, s’il ne fait que confirmer une interprétation stricte et bien connue de la loi sur la presse, est rendu dans un contexte mouvementé. Alors que, sous le précédent quinquennat, il avait été question de sortir de la loi de 1881 toutes les dispositions relatives au racisme, ce sont précisément celles relatives à l’injure et à la diffamation qui aurait pu s’en émanciper si le projet de la Garde des sceaux, vivement contesté, n’avait été finalement enterré par le Premier ministre à l’été 2019. La loi de 1881 résiste, encore et toujours…
Willems Guiriaboye
Stagiaire
Jérémie Leroy-Ringuet
Avocat
Cour de cassation, 1e chambre civile, 12 Septembre 2019 – n°18-23108
Décision non publiée, communiquée sur demande à contact@taoma-partners.fr
28
juin
2019
Parodie : Le Point fait rire la Cour de cassation
Author:
teamtaomanews
Le 19 juin 2014, le journal Le Point publiait un numéro dont la Une représentait, sous l’intitulé « Corporatiste intouchables, tueurs de réforme, lepéno-cégétistes… Les naufrageurs – la France coule, ce n’est pas leur problème », un buste de Marianne à demi submergé.
Il est cependant apparu que le journal n’avait pas recherché l’autorisation de l’auteur de la sculpture apparaissant dans ce photomontage, Alain Gourdon, dit Aslan, avant de procéder à la publication. Le sculpteur étant décédé, son épouse (investie de l’ensemble de ses droits) a assigné le Point en contrefaçon. Après le rejet de sa demande par les juges du fond, c’est la Cour de Cassation qui, par un arrêt du 22 mai 2019, a définitivement mis fin aux prétentions de la demanderesse.
Dans sa décision, la Cour marque son accord avec la qualification de parodie donnée à la Une de l’hebdomadaire par la cour d’appel. En effet, l’article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle indique que « lorsqu’une œuvre est divulguée, l’auteur ne peut interdire […] 4° la parodie, le pastiche ou la caricature, compte tenu des lois du genre », ces dernières n’étant pas définies légalement.
La Cour de Justice de l’Union Européenne[1] avait déjà apporté un éclairage sur les caractéristiques que devaient présenter une œuvre pour pouvoir être considérée comme une parodie, à savoir :
Évoquer une œuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci ;
Constituer une manifestation d’humour ou une raillerie.
En revanche, elle avait souligné que la notion de « parodie » n’était pas soumise à des conditions selon lesquelles elle devrait présenter un caractère original propre, pouvoir raisonnablement être attribuée à une personne autre que l’auteur de l’œuvre originale, porter sur l’œuvre originale ou mentionner la source de l’œuvre parodiée.
S’agissant d’une notion autonome du droit de l’Union, c’est à la lumière de cette interprétation que la Cour de cassation s’est prononcée, validant la décision de la cour d’appel, qui avait relevé :
L’absence de tout risque de confusion avec l’œuvre originale, du fait des éléments propres ajoutés par le photomontage ;
L’existence d’une « métaphore humoristique du naufrage prétendu de la République » qui résultait dudit montage, peu important le caractère sérieux de l’article qu’il illustrait,
Sans chercher à savoir, en revanche, si la parodie portait sur l’œuvre elle-même, ce critère ayant été écarté par la CJUE.
Date et référence : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-12718
Lire la décision complète sur Legifrance
[1] CJUE, 3 septembre 2014, Deckym, C-201/13