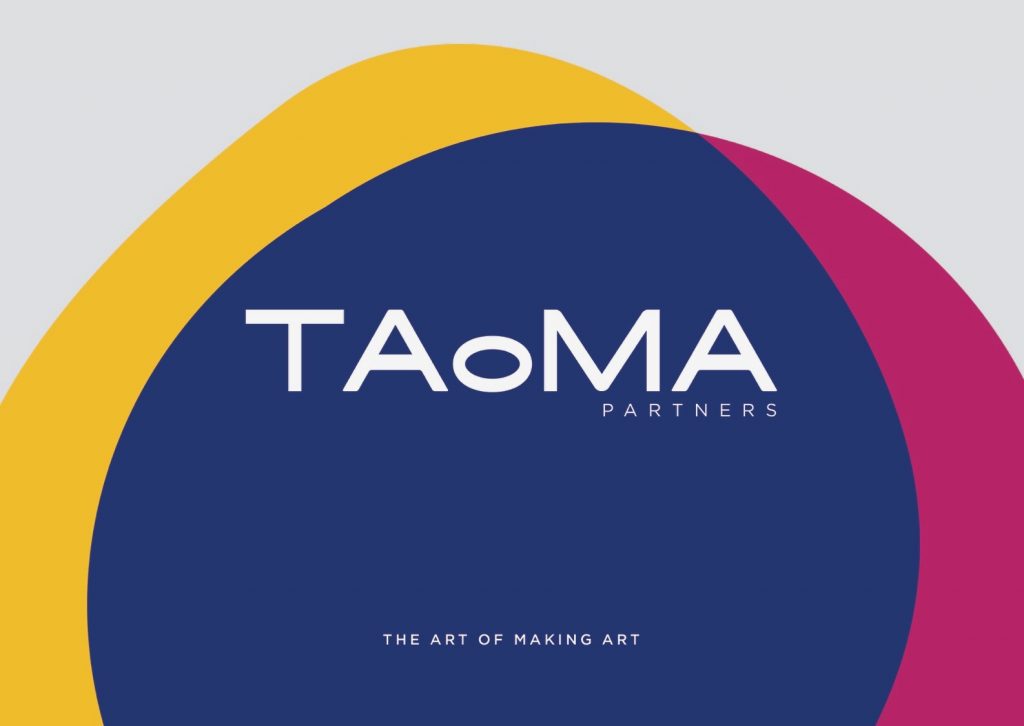23
avril
2024
Si l’artiste fait de l’art, la marque parasite
Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 27 mars 20241 a condamné la maison Givenchy au paiement de la somme de 30 000 Euros à l’artiste ZEVS pour avoir commis des actes de concurrence déloyale et parasitisme.
Quelques éléments de contexte
Monsieur Schwarz, connu sous le pseudonyme de ZEVS (se prononce Zeus), est un artiste français urbain de renom dans le milieu du Street Art. Il doit sa notoriété en partie grâce à la réalisation d’une grande série d’œuvres créées à partir de la technique du dripping (ou coulure).
Il détourne ainsi de leur fonction d’origine des symboles de la société de consommation, et notamment des logos de grandes marques, pour donner l’impression qu’ils se liquéfient complètement. Pour ZEVS, les logos sont la pierre angulaire de l’identité des grandes marques donc s’ils se liquéfient, elles disparaissent, en quelque sorte.
En l’espèce, l’œuvre qui est au cœur de l’affaire qui nous occupe appartient justement à cette série de tableaux. En 2010, il réalise « Liquidated Google », ci-après reproduit :
Or, il découvre le 27 août 2020 que la société Givenchy proposait à la vente sur son site internet un t-shirt qui reprendrait, selon lui, les caractéristiques originales de l’œuvre précitée.
ZEVS assigne Givenchy en contrefaçon de ses droits d’auteur et subsidiairement, en concurrence déloyale et parasitisme.
Les juges reconnaissent l’originalité de l’œuvre Liquidated Google
ZEVS précise bien dans ses écritures qu’il ne revendique aucun droit d’auteur sur la technique de la coulure ou du dripping largement rependue dans l’art contemporain, mais bien sur le traitement visuel qu’il en a réalisé dans son œuvre « Liquidated Google ».
Les juges accueillent ce raisonnement en ce qu’ils reconnaissent que l’originalité du tableau réside bien dans la concrétisation du message de ZEVS au sein de l’œuvre matérielle. Il créé l’illusion que le signe est en train de fondre, de saigner, « comme pour le vider de son sens ou de son pouvoir ». Les choix esthétiques opérés par l’artiste pour concrétiser cette illusion traduisent l’empreinte de sa personnalité.
Précisons que l’appropriation du logo de la marque Google n’est pas discutée par le tribunal. Le travail de ZEVS se place directement dans le courant artistique de l’appropriation, consistant à reprendre des œuvres préexistantes, ou des signes distinctifs, pour se les approprier au sein d’une œuvre nouvelle. Il existe cependant une limite entre la liberté artistique qui découle directement de la liberté d’expression, et la contrefaçon. Jeff Koons en a justement fait les frais pour ses œuvres « Fait d’hiver »2 et « Naked »3 jugées contrefaisantes par les tribunaux français. En effet, pour les juges du fond, ces œuvres étaient en réalité des œuvres composites pour la réalisation desquelles, l’accord de l’auteur des premières œuvres était nécessaire.
Alors, Liquidated Google, œuvre composite ou œuvre à part entière dont la reprise d’un signe distinctif ne relève que de la liberté artistique ?
L’on regrette que ce ne soit pas le sujet en l’espèce, mais remarquons cependant le raisonnement des juges concernant la contrefaçon et le parasitisme allégués par ZEVS.
Givenchy n’a pas contrefait l’œuvre de ZEVS mais l’a parasitée
S’agissant du t-shirt commercialisé par Givenchy, les juges réfutent toute contrefaçon de l’œuvre Liquidated Google. En effet, le terme utilisé sur le t-shirt est « GIVENCHY » et non « GOOGLE », les coulures sont des broderies et non de la peinture, et elles sont différentes. Cela est suffisant pour les juges qui considèrent que les caractéristiques originales invoquées par l’artiste ne sont pas reprises (à savoir des coulures irrégulières de longueur différentes, qui dégoulinent de la partie supérieure de chaque lettre).
En revanche, le tribunal retient que les t-shirts commercialisés par GIVENCHY s’inspirent indéniablement des œuvres de l’artiste et notamment de « Liquidated Google ». Les juges considèrent qu’ils sont donc « de nature à créer, pour le consommateur de produits de marque de luxe, une confusion avec celles-ci et ce d’autant plus que les marques de luxe s’associent régulièrement pour leurs créations à divers artistes ».
Il en résulte que Givenchy s’est placée dans le sillage de ZEVS et a tiré indûment profit de sa notoriété. Le tribunal conclut également à des actes de concurrence déloyale puisque le succès d’une telle action n’est pas subordonné à l’existence d’un rapport de concurrence entre les partiesi. Les juges considèrent en effet que « par l’association de sa marque en capitales de couleurs vives sur fond noir, avec des broderies de même couleur que chaque lettre destinées à créer un effet de coulures de peinture, la société Givenchy s’est directement inspirée des créations de M.4 et de sa démarche artistique consistant à donner l’illusion d’une liquéfaction du logo d’une marque de luxe, même si le détail des caractéristiques originales de l’œuvre « Liquidated Google » n’est pas exactement reproduit. »
GIVENCHY est donc condamnée à verser à l’artiste 30.000 Euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme. Alors que ZEVS s’approprie des signes distinctifs en toute légalité, les marques qui s’inspireraient de son travail risquent quant à elles, de se rendre coupables de parasitisme…
Il est indéniable que la concurrence déloyale et le parasitisme sont des fondements juridiques qui peuvent être souvent efficaces pour protéger ses créations lorsque la contrefaçon n’est pas retenue.
L’équipe de TAoMA est à vos côtés pour vous accompagner et vous conseiller au mieux dans la protection de vos créations mais également dans leur défense. N’hésitez pas à nous contacter.
Juliette Descamps
Stagiaire élève-avocat
Jean-Charles Nicollet
Conseil en Propriété Industrielle Associé
(1) Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 3e section, 27 mars 2024, n° 21/04132
(2) Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2018, n° 15/02536
(3) CA Paris, pôle 5 – ch. 1, 17 déc. 2019, n° 17/09695
(4) Cour de cassation, 3 mai 2016 n°14-24.905
31
janvier
2023
Imiter n’est pas créer : Attention au boomerang !
Author:
TAoMA
Bijoux de fantaisie : la concurrence fait rage. En quelques années, le marché des bijoux de fantaisie s’est fortement développé et il peut parfois être difficile de se distinguer de la concurrence, en particulier compte-tenu de l’encombrement créatif dans le secteur. Cet encombrement créatif a joué en faveur de la société Atiwell, dans le cadre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, le 2 novembre 20221.
La société Zag bijoux a assigné la société Atiwell le 26 avril 2019, pour des actes de concurrence déloyale et parasitaire liés à la commercialisation de bijoux en apparence identiques aux modèles de ses propres collections, mais de qualité médiocre et de moindre prix.
Le Tribunal de commerce de Bobigny a débouté la société Zag bijoux de ses demandes par jugement en date du 17 novembre 2020. En particulier, le Tribunal de commerce de Bobigny a considéré que les bijoux commercialisés par la société Zag Bijoux relevaient plus de la fantaisie commune que de produits originaux. Dans ce contexte, la société Atiwell pouvait s’en inspirer, sans contrevenir aux usages honnêtes et loyaux qui doivent présider à la vie des affaires.
Mécontente de cette décision, la société Zag Bijoux a porté l’affaire devant la Cour d’appel de Paris qui a confirmé le jugement.
En effet, et après une analyse minutieuse des modèles de bijoux de la société Zag bijoux, la Cour d’appel conclu qu’il existe des différences certaines entre les bijoux en cause et, par ailleurs, elle constate que de nombreux modèles de bijoux de la société Zag bijoux s’inscrivent dans la tendance du marché et, de surcroît, s’inspirent fortement de modèles protégés antérieurement au titre du droit des dessins et modèles, par d’autres concurrents.
La Cour en conclut que
• Il ne peut y avoir de risque de confusion entre les modèles de bijoux en cause, dès lors que la société Zag Bijoux s’est elle-même inspirée de modèles tombés dans le domaine public et/ou appartenant à la tendance actuelle du secteur. De même la Cour d’appel écarte également l’existence d’un effet de gamme sur cette base, puisque les éléments repris sont usuels et banals dans le secteur de la bijouterie ;
• La société Zag Bijoux ne justifie pas d’une valeur individualisée dont il résulterait des efforts créatifs, ainsi que des investissements. La concurrence déloyale et parasitaire est donc également rejetée par la Cour d’appel de Paris.
Cet arrêt, qui s’inscrit dans la jurisprudence actuelle, laisse entendre que les créations qui proviennent de l’imitation et/ou sont inspirées de la tendance du secteur ne peuvent pas être protégées par l’action en concurrence déloyale ou parasitaire. On doit préciser que ces créations ne seraient pas, a fortiori, protégées par le droit d’auteur.
Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
(1) Cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 2 novembre 2022, n°21/00039 ;
12
novembre
2021
Marque de champagne : l’abus procédural peut nuire à la santé
Author:
teamtaomanews
Le Tribunal judiciaire de Paris a récemment rendu une décision en matière de contrefaçon et, subsidiairement, de concurrence déloyale et de parasitisme, qui sonne comme un avertissement contre l’instrumentalisation de la justice à des fins d’éviction de concurrents. La décision est devenue définitive.
Cette affaire opposait deux sociétés productrices de vins de Champagne situées dans le même village : la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET, demanderesse, qui commercialise du champagne sous cette même appellation et la société CALX qui en commercialise sous le nom « LUCIEN COLLARD ».
Titulaire de deux marques semi-figuratives, une française de 2013 et une européenne de 2016, la demanderesse reprochait à CALX de commercialiser des vins de Champagne avec des étiquettes qui « présentent une physionomie extrêmement proche de ses marques ». Il faut préciser que les étiquettes litigieuses reproduisent la marque verbale française « LUCIEN COLLARD », du nom de son titulaire, le président de CALX :
Marque européenne de la demanderesse et exemple d’étiquette de la défenderesse
Dans une dispute qu’on devine être une querelle de clocher entre producteurs voisins, la société demanderesse a donc tenté d’agir sur le terrain de la contrefaçon en reprochant à la défenderesse, à l’occasion de son entrée sur un marché scandinave où elle était établie de longue date, l’utilisation non autorisée de sa marque antérieure.
On notera tout d’abord une intéressante requalification par le tribunal d’une fin de non-recevoir en demande reconventionnelle en nullité, dont elle déboute la défenderesse : celle-ci avait tenté de faire déclarer la demanderesse irrecevable à agir sur le fondement de sa marque européenne de 2016, postérieure au droit d’auteur invoqué sur l’étiquette de la défenderesse. Les éléments verbaux des signes en présence étant totalement différents, la demande reconventionnelle est rejetée.
Sur la demande principale en contrefaçon, le tribunal procède à une analyse du risque de confusion et en exclut la possibilité, de façon peu surprenante au vu des données de fait. Il considère que, si les produits désignés sont « pour une très large part identiques », l’élément dominant de la marque antérieur est son élément verbal et qu’il est très différent de celui utilisé par la défenderesse (« André Clouet » vs « Lucien Collard »).
Le caractère onéreux du produit concerné confère au public pertinent « un niveau d’attention un peu plus élevé que pour d’autres boissons alcoolisées ». Cette attention élevée a pour effet de neutraliser les éléments figuratifs différents dans les deux étiquettes, objets de la demande de contrefaçon qui est donc rejetée.
Les demandes relatives à la concurrence déloyale et au parasitisme subissent le même sort.
Le Tribunal reprend une analyse similaire pour comparer les étiquettes en présence et ajoute que les ornements utilisés relèvent d’un « procédé connu, qui a été couramment utilisé par de nombreux exploitants de Champagne » et qui est donc banal.
Le tribunal n’a pas reconnu non plus le parasitisme car la défenderesse a apporté la preuve qu’elle a effectué des investissements pour la conception et le packaging de ses bouteilles à travers une société spécialisée dans l’habillage des vins.
Le caractère radicalement infondé des demandes formulées, ajouté à certains éléments de contexte, a amené le Tribunal à entrer en voie de condamnation pour procédure abusive.
En effet, les parties coexistaient déjà sur le marché depuis quatre ans et la demanderesse n’a allégué un risque de confusion qu’après avoir constaté que sa concurrente avait remporté un appel d’offres sur le marché scandinave, notamment norvégien, où elle était elle-même présente. De plus, la proximité géographique des parties, situées dans une même commune de moins de 1.000 habitants, et leur appartenance à un même secteur d’activité permettent de conclure que la demanderesse avait nécessairement connaissance des étiquettes utilisées par la défenderesse bien avant l’invocation d’une confusion par lettre de mise en demeure en juin 2019.
Le tribunal conclut alors que l’action en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitisme intentée par la demanderesse « n’a été motivée que par sa volonté délibérée d’entraver la société CALX dans le développement de son activité », reconnaissant ainsi le caractère abusif de la procédure et condamnant la demanderesse à 5.000 euros de dommages-intérêts et 15.000 euros d’article 700.
La décision illustre le risque que peuvent prendre les justiciables à tenter d’évincer un concurrent en instrumentalisant des outils légaux et l’institution judiciaire.
Référence et date : Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre, 1e section, 29 juillet 2021, RG n° 19/13569
Décision non publiée, communiquée sur demande à contact-avocat@taoma-partners.fr
Salomé Hafiani Lamotte
Stagiaire – Pôle Avocats
Jérémie Leroy-Ringuet
Avocat à la cour