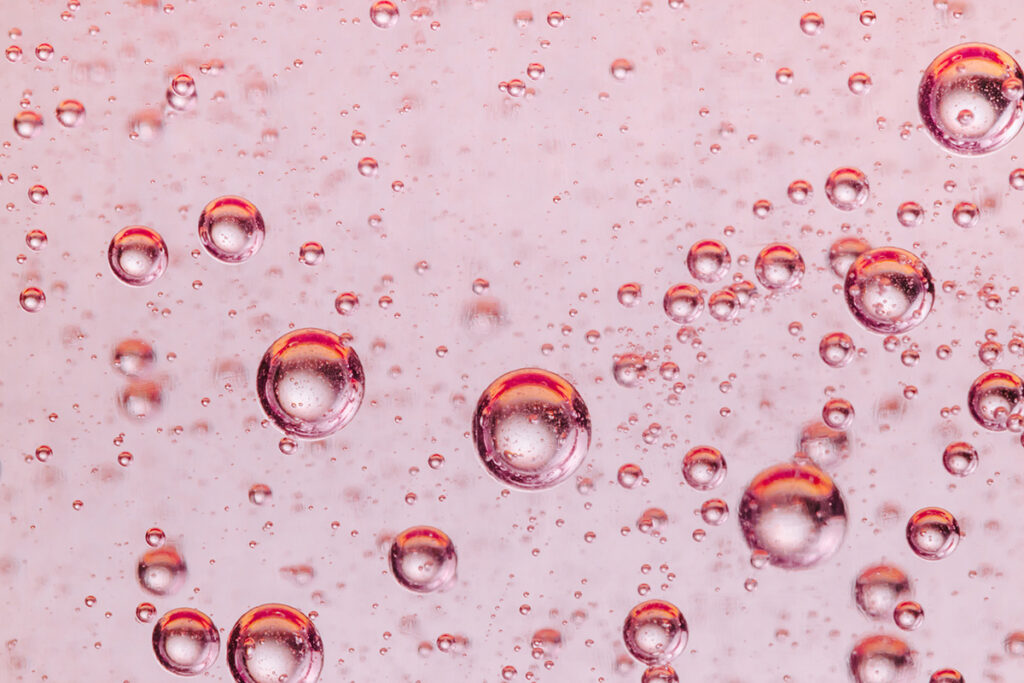23
juillet
2024
CHANEL N°5 vs. 5 – Une décision au parfum de surprise
Par une décision du 17 juin 20241, l’Office Européen de la Propriété Industrielle (ci-après EUIPO) a rejeté l’opposition formée par la Maison Chanel contre la demande de marque de l’Union européenne semi-figurative n°18872562, déposée pour des produits tels que des crèmes parfumées, des huiles essentielles ou des sérums de beauté en classe 3.
En effet, considérant que cette demande de marque risquait de créer un risque de confusion dans l’esprit du public avec ses célèbres marques antérieures françaises n° 98755754 et N°5 n°1293767, Chanel a formé opposition contre l’ensemble des produits désignés en classe 3. La maison de luxe a notamment invoqué la renommée et le degré de distinctivité élevé de ses marques antérieures au soutien de son opposition, en raison de leur utilisation longue et intensive.
Malgré la reconnaissance de l’identité des produits en comparaison et la similarité visuelle et phonétique des signes, l’Office européen ne reconnaît pas le risque de confusion.
L’Office estime de manière surprenante que les marques antérieures et N°5 de Chanel jouissent d’un caractère distinctif normal en ce qu’elles n’ont aucune signification pour les produits désignés en classe 3, au regard des preuves fournies par Chanel. Il est ainsi reproché à Chanel de ne pas avoir fourni de preuves suffisantes permettant de démontrer que ses marques antérieures ont un degré élevé de distinctivité et sont sérieusement utilisées pour les produits désignés.
L’examinateur considère en outre que les différences entre les signes sont « frappantes et seront facilement mémorisables ». Ces différences sont renforcées par le fait que ce sont des signes courts. En effet, il est de jurisprudence constante que de faibles différences au sein de signes courts sont plus facilement perceptibles par le public pertinent d’attention moyenne, donnant lieu à une impression générale différente.
En l’espèce, la représentation de la marque contestée combinant la lettre « n » avec le chiffre « 5 » en un seul élément graphique est jugée « inhabituelle » par l’Office. Cette singularité aurait donc un impact immédiat sur la perception des consommateurs, les guidant vers la conclusion que les produits en question ont une origine commerciale distincte.
Par conséquent, l’EUIPO rejette l’opposition dans son intégralité.
Cette décision révèle que les marques les plus prestigieuses ne sont pas exemptées de fournir une démonstration suffisante de la renommée et du degré élevé de distinctivité de leurs marques. La renommée et le caractère distinctif ne sont pas automatiquement reconnus et doivent être sérieusement prouvés par l’opposant.
Compte tenu de la teneur de cette décision, il existe de fortes chances que Chanel fasse appel.
Margaux Maarek
Juriste en Propriété industrielle
(1) EUIPO, décision d’opposition n° B 3 203 223 du 17 juin 2023
04
juin
2024
NUTELLA vs. MOZARTELLA : La bataille des tartines !
Le 5 avril 2024, la Division d’Opposition de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) a rejeté dans son intégralité l’opposition formée par la société Ferrero S.p.A., titulaire de la célèbre marque NUTELLA contre la demande de marque européenne MOZARTELLA, déposée par John Wambua1.
La société Ferrero S.p.A., s’est opposée à cette demande, en classes 29 et 30, en invoquant notamment l’article 8 paragraphe 5 du Règlement sur la marque de l’Union européenne, qui protège les marques de renommée de l’Union européenne tout comme les marques nationales jouissant d’une renommée au sein d’un État membre, et ce même en l’absence d’identité ou de similarité entre les produits et services désignés par les signes. Cette renommée permet au titulaire de la marque antérieure renommée de s’opposer à une demande de marque identique ou similaire dont « l’usage sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ».
Les marques NUTELLA jouissent d’une renommée en France et en Italie pour les pâtes à tartiner, désignées en classe 30
La renommée d’une marque implique qu’elle soit connue par une partie significative du public pertinent pour ses produits ou services. Dans le cas présent, la demande de marque contestée a été déposée le 02/12/2022, et l’opposante devait prouver que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date.
Les preuves doivent démontrer que cette renommée existait pour les produits spécifiques revendiqués, essentiellement les pâtes à tartiner contenant du cacao. Les documents soumis montrent un usage de la marque NUTELLA depuis 1965, avec une présence forte et continue sur le marché, des volumes de ventes élevés, et une publicité significative. Des enquêtes de marché et des articles de presse confirment la renommée de la marque, soutenue par des décisions judiciaires en France et en Italie.
Ainsi, la Division d’Opposition conclut que les marques antérieures jouissent d’une renommée en France et en Italie, pour les produits concernés, en classe 30.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré, et ne partagent aucune similitude conceptuelle
La Division d’Opposition indique que la marque antérieure NUTELLA est distinctive et sans signification particulière. La demande contestée, quant à elle, distinctive pour le public pertinent, peut être associée aux termes « MOZARELLA/MOZARELLE » (un type de fromage) ou au compositeur Mozart.
La société Ferrero S.p.A. soutient qu’il existe des similitudes visuelles et auditives entre les signes en cause, en se fondant notamment sur des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. La Division d’Opposition rappelle néanmoins qu’elle n’est pas liée par ses décisions antérieures, chaque cas devant être traité séparément et en tenant compte de ses particularités.
Selon l’Office, « visuellement et auditivement, les signes ont une longueur, un rythme et une intonation différents ; les marques antérieures sont composées de sept lettres tandis que le signe contesté est composé de dix lettres. Les signes coïncident dans leurs lettres finales « -TELLA ». Cependant, ils diffèrent dans les débuts plus visibles et audibles « NU » contre « MOZAR » qui sont composés de lettres complètement différentes et ont une longueur très différente. ». Ce raisonnnement se fonde notamment sur un jugement du Tribunal de l’Union Européenne selon lequel « le public n’est généralement pas conscient du nombre exact de lettres dans une marque verbale et, par conséquent, ne remarquera pas, dans la majorité des cas, que deux marques en conflit ont le même nombre de lettres ».
Par conséquent, contrairement aux arguments de l’opposant, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré.
Conceptuellement, pour la partie du public qui associera le signe contesté au contenu sémantique susvisé, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Pour la partie du public qui n’associera pas le signe contesté à une signification, la comparaison conceptuelle n’est pas possible et l’aspect conceptuel n’influence pas l’évaluation de la similitude des signes.
La Division d’Opposition juge « peu probable » le lien mental entre les signes par le public pertinent
Les marques antérieures sont réputées, mais les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et auditive.
Pour démontrer un risque de confusion, il faut établir que le public pertinent associera les signes en cause, « compte tenu de tous les facteurs pertinents » (le degré de similitude entre les signes, la force de la renommée de la marque antérieure, l’existence d’une probabilité de confusion de la part du public, etc.).
Pour établir un lien entre les marques, les sections pertinentes du public pour les produits et services doivent se chevaucher. Dans le cas présent, les produits appartiennent au même secteur de marché des denrées alimentaires et des boissons, mais les signes ont des différences frappantes, rendant improbable l’association par le public.
Ainsi, « malgré la similarité de marché et de distribution des produits alimentaires, les signes ont un faible degré de similitude visuelle et auditive, et une association conceptuelle n’est pas possible. La terminaison « TELLA » de « MOZARTELLA » ne sera pas perçue séparément ». Ainsi, l’opposition est rejetée car un lien mental entre les signes est improbable.
Il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en cause, malgré la renommée dont jouissent les marques antérieures
Selon l’article 8(1)(b) du RMUE, un risque de confusion existe si le public peut croire que les produits ou services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées.
Cette évaluation globale dépend de facteurs interdépendants tels que la similitude des signes, des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, et le public pertinent. La similitude est une condition préalable pour l’application des articles 8(1)(b) et 8(5) du RMUE. L’article 8(1)(b) nécessite un degré de similitude suffisant pour engendrer une confusion, tandis que l’article 8(5) exige seulement un lien entre les marques.
Dans ce cas, malgré une certaine renommée de la marque antérieure, les similitudes entre les signes sont jugées insuffisantes pour établir un lien ou un risque de confusion, conduisant au rejet de l’opposition en vertu de l’article 8(1)(b) du RMUE.
La décision souligne l’importance des différences distinctives dans l’évaluation de la similitude des marques et réaffirme que même des marques renommées ne peuvent pas toujours empêcher l’enregistrement de marques similaires, surtout lorsque les différences sont suffisantes pour éviter une confusion dans l’esprit du public.
***
Contactez TAoMA pour obtenir des conseils personnalisés ici.
Besoin de vous former ou de former vos équipes aux bonnes pratiques sur le sujet ?
Découvrez les ateliers de TAoMA Academy en nous contactant ici.
Gaëlle Bermejo
Conseil en Propriété Industrielle
(1) Décision de la Division d’Opposition, EUIPO, OPPOSITION Nо B 3 191 441, 05 avril 2024
28
mai
2024
Spoiler Alert ! L’immatriculation d’une société ne présume pas l’exploitation commerciale de sa dénomination sociale
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 mars 20241 vient préciser les contours de l’usage dans la vie des affaires d’une dénomination sociale. La simple immatriculation d’une société est-elle, en soi, constitutive d’un usage dans la vie des affaires de sa dénomination sociale ?
L’usage dans la vie des affaires : une notion centrale en droit des marques
Lorsque le titulaire d’une marque n’a pas autorisé l’usage par un tiers, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à celle-ci, et pour des produits ou services identiques ou similaires, alors il s’agit d’une contrefaçon2.
Une société ne peut donc pas faire usage d’une dénomination sociale identique ou similaire à une marque antérieure, si les produits ou services relatifs à son activité sont identiques ou similaires à celle-ci (sauf à prouver la renommée de cette marque, bien sûr). Or, en l’espèce, la marque antérieure portait sur le signe « Mix Beauty » et la dénomination sociale immatriculée postérieurement à son enregistrement portait sur un signe strictement identique.
Cependant, pour porter atteinte à la marque antérieure, l’usage de la dénomination sociale doit être réalisé « dans la vie des affaires ». Le tribunal judiciaire de Paris rappelle donc trois décisions fondamentales du Tribunal et de la Cour de justice de l’Union européenne précisant ces notions :
• « Faire usage » d’un signe signifie que son utilisation est faite dans le but de distinguer des produits ou des services. Ainsi, l’utilisation de la dénomination sociale doit porter atteinte, ou être susceptible de porter atteinte aux fonctions essentielles de la marque antérieure3.
• Les termes « usage dans la vie des affaires » ne sauraient être interprétés en ce sens qu’ils visent uniquement des relations immédiates entre un commerçant et un consommateur. Ainsi, il y a usage dans la vie des affaires lorsque l’opérateur économique concerné utilise cette dénomination sociale dans le cadre de sa propre communication commerciale4, ou lorsque cet usage se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique5.
Le titulaire de la marque antérieure doit donc démontrer que l’usage de la dénomination sociale litigieuse est réalisé dans le contexte de la vie des affaires, et qu’en cela, il porte atteinte aux fonctions essentielles de la marque.
La simple immatriculation d’une société sous une certaine dénomination n’est pas une présomption d’usage dans la vie des affaires
En l’espèce, les demandeurs n’avaient produit qu’une seule pièce aux débats, à savoir l’extrait Kbis de la société Mix Beauty. Ce document ne fait qu’établir l’enregistrement de cette société sous la dénomination « Mix beauty » auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris.
Or, pour le tribunal, ce seul document n’est pas suffisant pour prouver un usage dans la vie des affaires de la dénomination « Mix Beauty ». En effet, il considère que le seul fait d’immatriculer une société sous une certaine dénomination n’est pas, en lui-même, un usage de cette dénomination dans le but de distinguer des produits ou services. Par conséquent, cette seule immatriculation n’est pas susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.
Le tribunal conclut en ces termes « il s’agit d’un acte dont l’effet est strictement juridique, qui ne caractérise pas en soi l’existence d’une activité, et il ne peut être présumé que, du seul fait qu’une société existe sous une dénomination, elle est exploitée sous cette même dénomination ». Les demandeurs avaient pourtant produit des attestations établissant des confusions entre les adresses, notamment par des candidats dans le cadre de campagnes de recrutement. Mais ce n’est pas suffisant pour les juges pour qui l’atteinte à la marque « Mix Beauty » n’est pas établie.
Ce jugement est l’occasion de rappeler un principe fondamental en matière de procédure civile ; le juge ne peut suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve des faits qu’elles allèguent. Il est donc opportun de produire un maximum de documents établissant un usage de la dénomination sociale dans la vie des affaires, tels que des documents commerciaux par exemple. Ou de mettre la société sous surveillance et d’attendre les premiers actes d’usage et les faire constater.
Contactez TAoMA pour obtenir des conseils personnalisés ici.
Besoin de vous former ou de former vos équipes aux bonnes pratiques sur le sujet ?
Découvrez les ateliers de TAoMA Academy en nous contactant ici.
Anne Messas
Avocate associée
Juliette Descamps
Élève-avocate
(1) TJ Paris, 3e ch., 3e. sect., 27 mars 2024, n°23/13398
(2) Article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle
(3) CJUE, 25 juillet 2018, Mitsubishi, C-129/17, point 34
(4) CJUE, 16 juillet 2015, TOP Logistics e.a., C-379/14, points 40 et 41
(5) TUE, 3 mars 2016, Ugly Inc. c/ OHMI et Group Lottus Corp., T-778/14, point 28
16
janvier
2024
elLle hôtels n’est pas ELLE magazine : au Japon, entre dormir et lire, pas besoin de choisir !
Est-il encore nécessaire de présenter le magazine ELLE édité par la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE ? Avec des éditions dans la plupart des grands pays du monde, le magazine ELLE fait figure de concurrent direct de VOGUE.
Au fil des année la marque a vu son aura s’étendre à d’autres domaines d’activité que les magazines par le biais de produits dérivés, principalement dans la mode, mais également dans les services avec l’ouverture de cafés, restaurants et même d’hôtels (le premier à Paris, Maison ELLE).
C’est dans ce contexte que HACHETTE FILIPACCHI PRESSE s’est opposée devant l’office japonais au dépôt de la marque en mai 20231.
Le dépôt de cette marque fait suite à de premiers échanges entre la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et le déposant. Ce dernier avait, en effet, procédé au préalable au dépôt de la marque ELLE HOTELS qu’il avait retiré suite à une mise en demeure.
Fondements invoqués par HACHETTE FILIPACCHI PRESSE
Au soutien de son opposition, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE fait valoir que la marque litigieuse ne peut être enregistrée car elle est identique ou similaire à sa marque antérieure.
Par ailleurs, elle s’appuie sur une autre disposition de la loi japonaise qui prévoit qu’une marque ne peut pas être enregistrée lorsqu’elle est susceptible de créer une confusion avec les produits ou services notoires d’autres entités commerciales.
HACHETTE FILIPACCHI PRESSE explique que la marque ELLE bénéficie d’une réputation remarquable sur le marché et qu’elle est utilisée à travers le monde pour différents produits et services dont des cafés et des hôtels.
De même, notamment en raison des échanges précédents qu’elle a eus avec le déposant, HACHETTE FILIPACCHI PRESSE invoque le fondement du dépôt avec une intention déloyale, c’est-à-dire l’intention de réaliser un profit déloyal, de causer un préjudice au propriétaire de la marque notoire ou toute autre intention déloyale.
Il est évident pour elle qu’il existe une ressemblance importante entre la marque et ses marques antérieures ELLE et que ce nouveau dépôt est fait avec une intention déloyale.
Pour l’office, elLle n’est pas ELLE
L’office japonais reconnais que la marque ELLE jouit d’une certaine renommée pour les magazines mais également pour les articles de mode.
A l’inverse, sur les services d’hôtellerie, l’office note que si un hôtel a été ouvert à Paris, ce n’est pas le cas au Japon. Par ailleurs, il considère que l’opposant ne démontre pas l’ampleur de la publicité ou des revenus découlant des activités d’hôtellerie. Ainsi, il n’est pas démontré que ELLE bénéficie d’une certaine notoriété pour ces services.
Concernant la similarité entre les marques, l’office n’est pas des plus complaisants. L’office reconnait que l’élément elLle est le principal de la demande contestée, HOTEL étant descriptif.
Néanmoins, l’élément elLle doit être analysé dans son ensemble. Il est composé de manière équilibrée entre une attaque « el », une finalité « le » et un élément central « L » dessiné de plusieurs couleurs qui peut aisément être vu comme la lettre européenne « L ».
L’élément elLle n’est pas un mot du dictionnaire et n’a pas de sens spécifique. Rien n’indique qu’il sera vu comme le mot « elle ». L’office considère qu’il est raisonnable de supposer que elLle sera reconnu et compris comme un mot inventé qui n’a pas de signification spécifique.
En conséquence, il n’existe pas de risque de confusion avec les marques antérieures ELLE.
Enfin, concernant un éventuel dépôt avec une intention déloyale, l’office ne fait pas droit aux demandes de HACHETTE FILIPACCHI PRESSE. Les échanges précédant l’affaire, entre les parties, ne sont pas des faits concrets suffisants pour conclure que le déposant a protégé sa marque dans un but illicite.
La marque contestée n’est donc pas utilisée dans le but d’entraver les activités de la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE ou de caractériser une atteinte à la réputation de ELLE.
Une décision surprenante
Cette décision n’est pas sans étonner ! Il peut, en effet, être entendu que la marque ELLE ne bénéficie pas d’une notoriété particulière pour des hôtels. Nombreux sont ceux qui n’ont pas connaissance de l’hôtel parisien Maison ELLE. Cela est probablement d’autant plus vrai pour le public japonais où, au jour du dépôt de la marque contestée, aucun hôtel ELLE n’était ouvert dans le pays.
La comparaison entre ELLE et elLle peut également s’entendre d’une certaine manière en raison des différences de langue, de prononciation ou encore de perception des marques pour le public japonais.
A l’inverse, il est étonnant que l’office ne retienne pas que ce dépôt de marque soit fait dans une intention déloyale. Le déposant était parfaitement au courant des marques ELLE protégées et utilisées pour des hôtels. Les faits démontraient une volonté du déposant de contourner les marques antérieures ELLE.
Néanmoins, même si l’intention déloyale avait été retenue, la décision finale aurait probablement été identique. Si les marques ne peuvent être confondues par le public japonais, un dépôt déloyal de la marque n’aurait pas d’incidence sur une absence de risque de confusion entre les signes…
Il est donc possible de dormir sur ses deux oreilles à l’hôtel sans crainte d’une mauvaise presse dans le magazine ELLE.
Jean-Charles Nicollet
Conseil en Propriété Industrielle – Associé
(1) Opposition No. 2023-900123
09
janvier
2024
LEGO contre LELE BROTHER : la bataille des briques dans le monde des marques !
Par une décision du 26 septembre 20231, l’EUIPO a fait droit à une opposition formée par la société Lego titulaire de la célèbre marque contre la demande d’enregistrement de marque No. 018571181.
La société Lego Juris s’oppose à cette demande en invoquant notamment l’article 8 paragraphe 5 du Règlement sur la marque de l’Union européenne, qui protège les marques de renommée de l’Union européenne tout comme les marques nationales jouissant d’une renommée au sein d’un État membre, et ce même en l’absence d’identité ou de similarité entre les produits et services désignés par les signes. Cette renommée permet au titulaire de la marque antérieure renommée de s’opposer à une demande de marque identique ou similaire dont « l’usage sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ».
La marque LEGO possède une renommée exceptionnelle au sein de l’Union européenne pour certains des produits désignés
Afin d’étayer sa renommée, la société Lego Juris produit différents éléments de preuves (articles de presse, rapports annuels, chiffres de ventes, décisions administratives ou judiciaires, etc.) auprès de la Division d’opposition de l’EUIPO pour attester de la renommée de sa marque à l’égard des produits suivants « jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport (compris dans la classe 28) ; décorations pour arbres de Noël », sur lesquels se fonde l’opposition.
Pour la Division d’opposition de l’EUIPO, les éléments apportés par la société Lego Juris démontrent que la marque LEGO « a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et qu’elle est notoirement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders […] » et que les éléments fournis possèdent une valeur probante en plus d’être fiables quant à leur date.
L’ensemble de ces preuves permettent à la Division d’opposition de conclure que la marque Lego « jouit d’une renommée exceptionnelle dans l’Union européenne », mais seulement pour les « Jeux, jouets à savoir jouets de construction », les « jouets de constructions » constituant une sous-catégorie autonome de la catégorie des jeux et jouets. S’agissant toutefois des « articles de gymnastique et de sport (compris dans la classe 28) ; décorations pour arbres de Noël », la Division d’opposition ne reconnait par la renommée de la marque en cause, faute de preuves suffisantes.
Un risque de confusion préjudiciable
Après avoir retenu l’exceptionnelle renommée de la marque antérieure, la Division d’opposition procède à l’analyse des signes en se conformant à la méthode globale d’appréciation du risque de confusion2.
Il est retenu, d’un point de vue visuel, que les signes présentent des ressemblances en raison de leur séquence d’attaque commune « LE- » et de leur reproduction dans des tons gris, encadrés par un carré, avec une stylisation et un agencement semblable des éléments verbaux. Malgré certaines différences entre les deux syllabes finales ou encore la longueur du signe contesté du fait de la présence du mot « BROTHER », la Division d’opposition considère que les signes « présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne » sur le plan visuel.
La Division d’opposition retient ensuite que les signes présentent également certaines ressemblances d’un point de vue phonétique. Les éléments verbaux commencent tous deux par la séquence « LE- » en plus de partager les mêmes voyelles « E » et « O ».
Ils diffèrent néanmoins dans la prononciation de leur deuxième syllabe « GO » au sein de la marque antérieure et « LE » dans la demande contestée, et dans la prononciation de l’élément verbal supplémentaire « BROTHER » au sein de la demande contestée.
Ainsi, la Division d’opposition considère que les signes sont « faiblement similaires sur le plan phonétique ».
À cela s’ajoute une différence conceptuelle entre les deux marques, le consommateur moyen de l’Union européenne associant directement le terme « Lego » à la marque de jeu de construction ou à la société. S’agissant de la marque Lele Brother, le premier terme ne possède pas de signification particulière, tandis que le second élément verbal renvoie à la notion de « frère », le tout pouvant être perçu comme pouvant faire référence au « frère d’une personne nommée Lele ».
La Division d’opposition examine ensuite si le public sera en mesure d’établir un lien entre les marques en cause. Ce lien n’étant pas explicitement mentionné par l’article 8 paragraphe 5 du Règlement, il n’en demeure pas moins nécessaire de l’établir pour « déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce ».
Tenant compte du degré de similitude, de la renommée de la marque Lego pour certains produits, des similarités entre les produits respectivement désignés, et du fait qu’ils ciblent le même public, la Division d’opposition en conclut que les consommateurs concernés seront susceptibles d’associer la demande de marque contestée à la marque antérieure LEGO, c’est-à-dire d’établir un « a mental link » entre les signes.
Enfin, la Division d’opposition reconnait que la demande de marque Lele Brother risque de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque LEGO puisque « the ‘LEGO’ brand has a particularly high image and is regarded for its commitment to current social-political topics such as sustainability, child education and diversity. These positive qualities could be transferred and attached to the contested sign and this image transfer would make it easier to sell all the contested goods ». En d’autres termes, la société déposante pourrait injustement profiter de cette renommée sans payer de compensation à la société Lego Juris et sans investir pour créer un marché pour ses produits dans l’Union européenne.
Ainsi, se fondant sur l’ensemble des éléments précités, la Division d’opposition reconnait l’opposition formée par la société Legos Juris totalement justifiée et rejette donc la demande de marque contestée pour l’ensemble des produits couverts.
La demande de marque Lele Brother a fini par se prendre un ‘NON’ aussi solide que les briques LEGO. Il semble que dans ce match, LEGO ait construit une victoire indiscutable !
Arthur Burger
Stagiaire juriste
Gaëlle Bermejo
Conseil en Propriété Industrielle
Note de référence :
(1) EUIPO, Division d’opposition, 26/09/2023, n° B 3 159 692
(2) CJUE 11/11/1997, n° C-251/95, affaire Sabel / Puma
05
décembre
2023
LA MAISON DU CHOCOLAT JUGÉE NON-DISTINCTIVE POUR DÉSIGNER DES PRODUITS ET SERVICES VIRTUELS EN LIEN AVEC LE CHOCOLAT
Le 5 octobre 2023, la chambre des recours de l’EUIPO a confirmé la décision de refus partiel de la demande de marque de l’Union européenne LA MAISON DU CHOCOLAT n°18719890, d’avoir considéré que le signe était descriptif et dépourvu de caractère distinctif notamment pour des produits et services virtuels en lien avec du chocolat1.
La société La Maison du chocolat, spécialisée dans la fabrication de confiseries et la transformation de cacao, a déposé la demande de marque de l’Union européenne LA MAISON DU CHOCOLAT n°18719890 le 21 juin 2022 pour désigner des produits et services en classes 9, 35 et 41 auprès de l’EUIPO.
Par une décision du 23 février 2023, l’examinateur a partiellement refusé cette demande de marque au motif que le signe LA MAISON DU CHOCOLAT serait (i) descriptif de l’espèce et (ii) dépourvu de caractère distinctif.
En effet, il estime que le consommateur français (public retenu comme pertinent) est susceptible de percevoir le signe comme « un magasin sous forme de boutique maison qui vend et/ou produit du chocolat », qui viendrait, de ce fait, décrire l’espèce des produits désignés.
L’Office a notamment refusé les produits et services suivants à l’enregistrement :
– Classe 9 : « Produits virtuels téléchargeables à savoir programmes informatiques en relation avec le cacao et préparations à base de cacao, cacao en poudre, pâtes à tartiner au cacao (…) »
– Classe 35 : « Services de magasin de vente au détail en ligne proposant des biens virtuels à savoir du cacao, du cacao en poudre, des pâtes à tartiner au cacao (…) » ;
– Classe 41 : « Services de divertissement, à savoir offre en ligne de biens virtuels, à savoir du cacao et des préparations à base de cacao, du cacao en poudre, des pâtes à tartiner au cacao (…) ; »
Toutefois, ladite demande a été accueillie pour des produits et services virtuels en lien avec la pâtisserie.
La société demanderesse a formé un recours contre cette décision devant la Chambre des recours de l’EUIPO qui a, par une décision du 5 octobre 2023, confirmé la décision de l’examinateur en rappelant et appliquant les dispositions de l’article 7 §1 b et c et §2 du Règlement sur la Marque de l’Union européenne (RMUE).
En effet, une marque doit être refusée dès lors qu’elle est :
– composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir dans le commerce pour désigner l’espèce, la qualité etc … En l’espèce l’association des termes « LA MAISON DU » (qui forme à l’évidence une expression désignant une entreprise commerciale), au terme « CHOCOLAT » informe clairement les consommateurs sur l’espèce des produits et services en cause. Le consommateur percevra le signe comme un centre ou bâtiment qui fabrique/ produit/ vend du chocolat ou y trouver une expérience qui est liée au chocolat même, que cela soit dans le monde réel comme dans le monde virtuel.
– dépourvue de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne. En l’espèce, la marque demandée sera considérée pas le public pertinent comme indiquant seulement que les produits et services proviennent d’une entreprise commerciale spécialisée dans le chocolat ce qui constitue un message laudatif vantant la spécialisation et le caractère unique de l’entreprise commerciale.
Dès lors, elle confirme que la demande de marque en cause est descriptive des produits et services objectés, quand bien même ces derniers soient virtuels et rejette le recours de la demanderesse. LA MAISON DU CHOCOLAT est donc enregistrée pour les produits et services restants et notamment ceux en lien avec la pâtisserie.
Ce n’est pas la première fois que la demanderesse se voit refuser l’une de ses demandes de marque à l’enregistrement pour défaut de caractère distinctif par l’Office. En effet, elle avait déjà cherché à déposer le signe LA MAISON DU CHOCOLAT en 2003 pour des produits et services en classes 30 (cacao, pâtisserie et confiserie, sauces (condiments)) et 43 (services de restauration (alimentation)) sans succès. La tentative pour des produits et services du monde virtuel se heurte finalement aux mêmes refus de l’Office.
L’Office adopte ainsi la même appréciation de la distinctivité pour les marques désignant des produits virtuels que pour les marques désignant des produits matériels. En effet, d’après la Chambre des recours, le caractère virtuel de ces produits ou services ne modifie pas la perception du signe, tant qu’ils ont un lien avec le chocolat ou le cacao.
Cette décision témoigne donc de la volonté de l’EUIPO d’adapter le droit des marques aux nouveaux enjeux du virtuel.
Margaux Maarek
Juriste
Mélissa Cassanet
Conseil en Propriété Industrielle Associée
(1) EUIPO, Chambre des recours, 5 octobre 2023, R 836/2023-2
28
novembre
2023
Champagne vs. Champaign : pour l’EUIPO, les ingrédients ne sont pas réunis en cuisine pour rejeter la demande de marque !
Le Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne (CIVC) qui représente et défend les droits de l’AOP « Champagne » constate tous les jours des dépôts de marques comportant le mot « Champagne » ou faisant référence à l’univers du Champagne.
C’est sans conteste le cas de la demande de marque de l’Union Européenne « Champaign » déposée en juillet 2022 par la société américaine Monument Grill pour des produits de cuisson, de réfrigération, etc. Cette marque a la même prononciation anglosaxonne que le mot Champagne et se présente de la manière suivante :
Fidèle à son combat, le CIVC a formé opposition contre la demande de marque litigieuse afin de tenter d’empêcher son enregistrement.
Contre toute attente, l’EUIPO, en rupture avec sa propre jurisprudence et celle de la CJUE, a rejeté l’opposition du CIVC dans une décision datée du 10 octobre dernier en considérant que : « Même si les appareils et installations frigorifiques mentionnés peuvent être utilisés pour stocker du vin, les produits litigieux et le vin couvert par l’AOP Champagne sont très éloignés en termes de nature et d’aspect physique, de méthode de fabrication/élaboration et de destination ».
L’Office ajoute que le fait que les deux termes se prononcent de façon similaire « n’est pas suffisant pour que le public puisse établir un lien clair et direct entre la demande de dépôt de marque de l’Union Européenne contestée, pour des réfrigérateurs, et le produit protégé, du vin provenant de la région de Champagne ».
Enfin, l’CJUE considère que le public ne percevra pas une signification particulière dans le terme contesté « Champaign » dans la mesure où celui-ci signifie également en vieil anglais « étendue plate de campagne » ou « étendue de terrain plat », élément qui, selon lui, est de nature à démontrer l’absence de volonté délibérée de la société américaine de parasiter l’AOP Champagne.
Même si l’Office se justifie en précisant que cette décision « n’est pas remise en cause par les nombreuses décisions citées par le CIVC étant donné que les circonstances, les faits et les éléments de preuve à l’égard desquels ces affaires ont été appréciées étaient différents de l’espèce ». On l’aura compris, cette décision vient en rupture de la jurisprudence de la CJUE en la matière.
On peut en effet citer notamment l’affaire du bar à tapas espagnol « Champanillo » (notre news sur cette affaire ici) dans laquelle la CJUE, interrogée par la Cour de Barcelone, affirme que les AOP doivent être protégées à l’encontre d’une évocation se rapportant tant à des produits qu’à des services, en cas d’incorporation partielle de l’appellation protégée, de parenté phonétique et visuelle, de proximité conceptuelle ou de similitude entre les produits couverts par l’AOP et les produits et services couverts par le signe litigieux.
L’arrêt « Champanillo » pose ainsi le principe selon lequel les AOP sont protégées vis-à-vis de signes utilisés pour désigner des produits ou des services non couverts par l’appellation « Champagne » et démontre ainsi la volonté de la CJUE de garantir aux indications géographiques une protection étendue.
La voie que vient d’emprunter l’EUIPO est toute autre. Il convient toutefois de préciser qu’il s’agit là de la position de la Division d’Opposition.
Dans une affaire similaire, l’opposition contre le dépôt d’une marque de l’Union Européenne « Champagnola » par une société tchèque en classes 30 (pains et pâtisseries) et 40 (services de boulangerie et pâtisserie) avait été rejetée par la Division d’Opposition en 2019 au motif que les produits et services désignés par la demande n’étaient pas similaires au vin de Champagne et qu’il n’y avait en l’espèce ni usage commercial ni évocation et dès lors aucun risque de confusion.
Saisie d’un recours contre cette décision par le CIVC, la Chambre de Recours a annulé la décision, le 17 avril 2020, en refusant l’enregistrement de la marque « Champagnola » en classes 30 et 40 en considérant que celle-ci est une évocation certaine du terme Champagne et qu’elle exploite la renommée de l’AOP « Champagne », peu important que les produits et services visés ne soient pas similaires.
L’affaire Champaign est, depuis le 20 octobre, dans les mains de la Chambre de Recours de l’EUIPO qui optera pour la protection des appellations ou pour la poursuite du putsch engagé par la Division d’Opposition à l’égard de la CJUE.
Alors, Champagne ou pas ?
Juliette Biegala
Juriste
Jean-Charles Nicollet
Conseil en Propriété Industrielle Associé
21
novembre
2023
Un dépôt décoiffant et controversé : une marque représentant le visage d’une femme pour des services de mannequinat est-elle distinctive ?
Le 26 octobre 2017, la société Roos Abels Holding B.V. a déposé une demande de marque figurative représentant le visage d’une femme pour couvrir les « services de mannequins et de modèles photographiques pour la publicité ou la promotion des ventes » en classe 35 et les « services de modèles et de mannequins à des fins récréatives ou de loisirs » en classe 41.
Nous rappelons qu’aux termes de l’article 7, 1° b) et c) du Règlement sur la marque de l’Union européenne du 20 décembre 1993, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif » et « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
Un refus de l’EUIPO fondé sur l’absence de caractère distinctif : cette demande de marque ne présente aucune caractéristique particulière
En l’espèce, considérant que le signe était dépourvu de caractère distinctif à l’égard des services couverts, l’EUIPO a entièrement rejeté le 17 avril dernier cette demande de marque.
Cette décision était notamment fondée sur les constations suivantes :
– « L’image en cause ne consiste qu’en une représentation naturelle de la tête/du visage d’une (jeune) femme. Compte tenu de l’attention du public concerné, la marque demandée ne permet pas à ce public de distinguer immédiatement et infailliblement les services démandés d’apparences similaires d’une origine commerciale différente ».
– « Des images ou des photos de personnes apparaissent et sont utilisées dans le cadre de services de toutes sortes, principalement ceux liés à l’habillement et à la mode. Bien que ces images puissent représenter certaines personnes ou individus concrets, elles n’impliquent rien de plus qu’une représentation banale des personnes en général, de sorte que ces images sont comprises comme étant communes aux services en question (…) ».
– « La présente marque figurative ne présente aucune caractéristique particulière susceptible d’influencer la mémoire des consommateurs au point de distinguer les services demandés des autres. La forme de présentation n’est pas substantiellement différente d’autres représentations fidèles de la tête/du visage d’une (jeune) femme (…) ».
En désaccord avec cette appréciation, la société déposante a formé un recours contre cette décision le 16 juin 2023, faisant notamment valoir que :
– « La particularité et l’originalité sont des critères de distinction. Le visage d’un adulte est précisément l’élément du corps humain qui permet de distinguer une personne d’une autre (…). Les chambres de recours ont déjà décidé, à plusieurs reprises, que le public perçoit une image photographique d’une personne comme identifiant l’origine des produits et des services (…) ».
– « Le fait que les images de personnes soient généralement plus utilisées dans la vente ou la fourniture de produits et de services n’enlève rien au caractère distinctif de la présente demande. Tant que l’image faisant l’objet de la marque demandée est en elle-même reconnaissable et unique, elle peut servir de signe d’origine ».
– Outre le fait que le visage humain d’une personne adulte est une marque de distinction, la femme représentée est une personne connue dans le monde du mannequinat (…). Son visage est sa marque et avec son succès, elle a acquis une popularité et une renommée rachetables qui constituent un motif suffisant pour l’enregistrement de son portrait en tant que marque ».
La chambre de recours de l’EUIPO reconnait l’existence d’un caractère distinctif : ce signe est apte à remplir la fonction essentielle d’une marque
À la lumière de ces éléments, la chambre de recours a annulé la décision contestée et autorisé la publication de la demande de marque de l’UE No. 017393125 pour l’ensemble des services couverts, dans une décision rendue le 30 octobre 20231.
En premier lieu, la chambre de recours rappelle qu’il n’est pas nécessairement plus difficile d’établir le caractère distinctif de la marque figurative en cause simplement parce qu’il s’agit d’une représentation naturelle.
Elle considère en effet que « les caractéristiques particulières ou originales ne sont pas des critères du caractère distintif d’une marque, la marque en question doit permettre au public de distinguer les produits et services en cause de ceux d’autres entreprises ou personnes ».
En l’espèce, même s’il s’agit d’une représentation fidèle d’un visage de femme, cette image peut être interprétée comme une marque d’autant qu’elle n’évoque aucunement les services en cause. Ainsi, la chambre de recours considère que le public concerné percevra le signe comme identifiant l’origine des services couverts, à savoir qu’ils proviennent de la personne représentée.
En outre, la chambre de recours conteste le raisonnement de l’examinateur selon lequel, « en ce qui concerne les services demandés dans les classes 35 et 41 de mannequins et de modèles photographiques, l’image ne représenterait que la personne fournissant ces services ». Au contraire, selon elle, cette image permettra de distinguer l’origine commerciale de ces services.
Enfin, la chambre de recours déclare que le fait que la personne soit connue du public concerné n’a pas d’incidence sur son caractère distinctif intrinsèque.
A la lumière de cette décision, la chambre de recours de l’EUIPO considérerait-elle qu’un visage permet aussi facilement qu’un nom patronymique d’identifier des produits et services ?
Le cas échéant, les demandes de marques ne manqueront pas d’affluer chez les avares de célébrité… !
Gaëlle Bermejo
Conseil en Propriété Industrielle
(1) Décision de la quatrième chambre de recours du 30 octobre 2023
11
juillet
2022
Le TUE n’est pas d’humeur festive, Amsterdam Poppers descriptive
Si Amsterdam, capitale des Pays-Bas, est connue pour son patrimoine culturel et artistique, ainsi que ses richesses historiques, elle l’est tout autant pour sa vie nocturne et les plaisirs y associés. Ce fait, qualifié de notoire par le Tribunal de l’Union européenne (TUE) dans sa décision du 6 avril 20221, n’a pas joué en faveur de la société Funline International, déposante de la demande de marque AMSTERDAM POPPERS.
Le 15 décembre 2020, la société de droit américain Funline International a déposé auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) la demande de marque AMSTERDAM POPPERS pour désigner divers produits des classes 3 et 5, y inclus « produits à inhaler à vocation aphrodisiaque et/ou euphorisante ».
L’EUIPO a, dans le cadre de l’examen de cette marque, émis un refus total de protection de la marque sur la base des deux motifs suivants :
La marque AMSTERDAM POPPERS est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs dès lors qu’elle fait référence à une drogue récréative ;
La marque AMSTERDAM POPPERS est descriptive des « produits à inhaler à vocation aphrodisiaque et/ou euphorisante » dès lors qu’elle sert à décrire la provenance des produits en cause, à savoir une substance récréative provenant de la ville d’Amsterdam.
Sur recours de la société Funline International, la Chambre d’appel de l’EUIPO a confirmé partiellement la décision de refus. En effet, si la Chambre d’appel de l’EUIPO déjuge l’examinateur concernant la contrariété à l’ordre public et aux bonnes mœurs au motif que la consommation de poppers n’est pas prohibée dans les États membres, elle maintient la conclusion selon laquelle la marque AMSTERDAM POPPERS est descriptive pour les « produits à inhaler à vocation aphrodisiaque et/ou euphorisante ».
La demande de marque AMSTERDAM POPPERS a donc été acceptée à l’enregistrement pour l’ensemble des produits qu’elle désigne en classes 3 et 5, exception faite des « produits à inhaler à vocation aphrodisiaque et/ou euphorisante ».
C’était sans compter la détermination de la société Funline International qui a porté l’affaire devant le TUE afin d’obtenir l’annulation de la décision au motif qu’elle violerait l’Article 7, paragraphe 1, sous c), du Règlement 2017/10012.
En effet, la société Funline International considérait que la marque AMSTERDAM POPPERS ne pouvait être considérée comme descriptive dès lors que la ville d’Amsterdam n’était pas connue pour la production de poppers, de sorte qu’il n’existait aucun lien direct entre le lieu géographique et le produit en cause. Par ailleurs, la société américaine affirmait que la combinaison des termes AMSTERDAM et POPPERS était inhabituelle, conférant à l’ensemble un caractère arbitraire au regard des produits objectés.
Le TUE dans sa décision du 6 avril dernier rejette les arguments ci-dessus et confirme la décision de la Chambre d’appel de l’EUIPO.
En ce sens, le TUE rappelle la jurisprudence classique selon laquelle une marque composée de plusieurs termes descriptifs et/ou de termes géographiques peut faire l’objet d’un enregistrement à titre de marque au sein de l’Union européenne, à la condition toutefois que (i) la combinaison ne soit pas elle-même descriptive et (ii) qu’il n’existe pas de lien direct entre le lieu géographique et le produit désigné.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque, contrairement à ce qu’affirme la société Funline International :
le terme AMSTERDAM sera nécessairement associé à la ville du même nom qui est notoirement connue pour sa tolérance concernant l’usage de drogues ;
le terme POPPERS renvoie directement à la nature des produits en cause, à savoir une substance qui est généralement utilisée dans un cadre festif.
Aussi, il existe un lien direct entre le lieu géographique utilisé et les produits objectés, le public pertinent pouvant raisonnablement penser que les produits en cause proviennent d’Amsterdam, ville réputée pour la consommation de ce type de produits.
Au surplus, le TUE considère de manière assez logique que la construction grammaticale de la marque demandée est banale, à tout le moins pour le public anglophone et francophone. La signification descriptive de la marque est effectivement immédiatement perceptible par ce public et ne nécessite pas particulièrement d’efforts intellectuels.
Il n’y aura donc pas de poppers à Amsterdam, le TUE confirme le rejet de la demande de marque AMSTERDAM POPPERS pour les « produits à inhaler à vocation aphrodisiaque et/ou euphorisante ».
Cette décision, en phase avec la jurisprudence classique de l’Union européenne, permet de rappeler les critères de protection des marques descriptives, en particulier quand elles sont composées d’une juxtaposition de termes descriptif et/ou d’un terme géographique. La vigilance reste donc de mise !
Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
1 Tribunal de l’Union européenne du 6 avril 2022, Funline International c/ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Affaire T-680/21 ;
2 « 1. Sont refusés à l’enregistrement: (…) c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci; »
Load more
Loading...